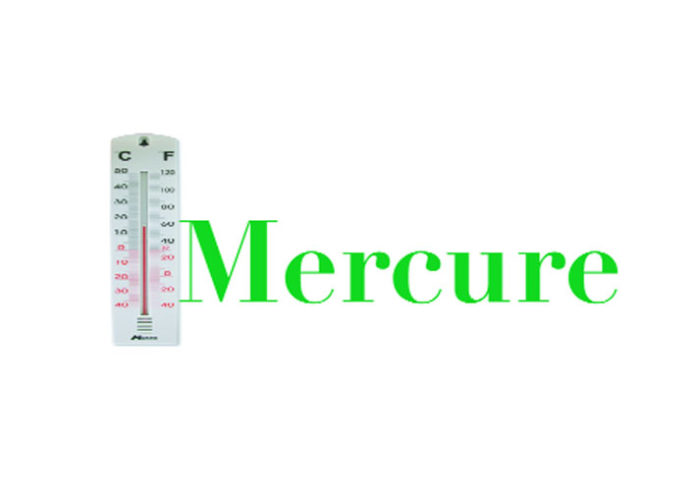Les effets de la suspension, en janvier dernier, de l’aide sanitaire américaine au Bostwana, pays d’Afrique australe de moins de 3 millions d’habitants, commence à se faire sentir. Comme il fallait s’y attendre, l’interruption de ce soutien, apporté depuis 2003 et de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année, a eu des répercussions sur des programmes de lutte contre certaines maladies, tel le VIH-SIDA.
Le gel des aides américaines a aggravé une situation économique déjà préoccupante, le Botswana étant confronté, ces dernières années, à la chute du prix du diamant dont il est l’un des plus grands producteurs mondiaux, en raison du ralentissement de la demande. Cet environnement d’austérité budgétaire a engendré une pénurie de médicaments dans les hôpitaux et les cliniques de Gaborone, la capitale et des autres villes du pays. Cette situation affecte l’offre de soins publics et expose le Président Duma Boko, au pouvoir depuis novembre 2024, à toutes sortes de critiques.
Aussi a-t-il déclaré, en ce début de semaine, l’état d’urgence sanitaire et a annoncé un financement d’urgence de plus de 18 millions de dollars pour réapprovisionner le pays en médicaments. Cette mesure s’imposait, tant la pénurie de médicaments menace des vies, si certaines n’en ont pas déjà fait les frais. Les populations ne peuvent plus avoir accès à divers types de médicaments contre des maladies sensibles comme l’hypertension, le cancer, le diabète et l’asthme.
Si le chef de l’Etat botswanais a réagi dans l’espoir de combler les attentes, l’on se demande si son gouvernement n’a pas manqué de prévision. L’exécutif botswanais n’a-t-il pas laissé la situation s’installer, avant d’agir en médecin après la mort, quand on sait qu’un bon système d’approvisionnement en médicaments anticipe sur les ruptures ? C’est l’impression qui se dégage. Il est évident que le Bostwana voit rouge à ses finances, un souci renforcé par les coupes budgétaires de l’administration Trump, mais, cela ne saurait justifier cette pénurie aux conséquences désastreuses.
La situation vécue par le Bostwana soulève à nouveau l’éternelle question de la bonne gouvernance et celle de la dépendance des Etats africains aux aides extérieures, fut-elles américaines. Les Etats africains, qui ne sont pas forcément démunis, mais mal organisés, doivent œuvrer à faire le ménage dans la gestion de leurs finances publiques et la conduite des politiques publiques. Si les ressources endogènes n’échappent pas à la prédation des commis de l’Etat, les aides extérieures ne sont pas toujours utilisées au profit des populations.
A priori, les aides financières ou la dette extérieure ne sont pas mauvaise en soi, à condition qu’elles soient utilisées à bon escient, qu’elles servent véritablement les causes mises en avant. Mais, le plus important, c’est de travailler à se passer des aides ou dettes extérieures autant que possible, de compter sur ses propres ressources. Les Etats africains doivent cesser d’apparaitre comme des bébés accros au biberon, d’éternels assistés. Le cas du Bostwana, pour le moins saisissant, illustre en partie les conséquences de la dépendance à l’aide extérieure, si l’on s’y accroche, au point de minimiser ses propres capacités et de se faire imposer des choix par des grandes puissances. « La seule garantie effective de la liberté, c’est encore et toujours l’indépendance financière », comme le dit si bien l’écrivain québécois, Jean-Claude Clari.
Kader Patrick KARANTAO