
Au Burkina Faso, l’insécurité routière fait de nombreuses victimes. Selon les chiffres de l’Office national de la sécurité routière (ONASER), sur 25 000 accidents recensés en moyenne chaque année, l’on enregistre 15 000 blessés et 1 000 décès. Face à ce drame causé principalement par le non-respect du Code de la route, d’anciens accidentés ont décidé de faire de leur amère expérience, un motif de combat. Devenus « ambassadeurs » de la sécurité routière, ces rescapés se mobilisent au sein d’associations pour sensibiliser la population et faire changer les comportements.
9 juillet 2020 ! Aziz Ouattara n’oubliera jamais cette date. Sorti de chez lui au quartier Somgandé dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, pour se rendre à Ziniaré, chef-lieu de la région de Oubri, à moto, sans casque, il se retrouve nez-à-nez, aux abords du parc Bangr-Weoogo, avec une femme (bébé au dos), qui traverse la route à moto. Les deux entre alors en collision. Si la jeune mère s’en sort indemne, Aziz Ouattara, lui, a failli y perdre l’un de ses yeux. Evanoui durant une trentaine de minutes, il reprend connaissance, paniqué à la vue du sang sur sa chemise.
Pourtant, il n’était pas au bout de ses « surprises ». Transporté d’urgence au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU/YO) par un bon samaritain, il ne reçoit cependant aucun soin. Pour cause, le personnel soignant observait un mouvement d’humeur lié à la pandémie de la COVID-19. Faute d’assistance, il est finalement conduit dans une clinique privée où un scanner révèle une fracture de l’os orbital droit. « On m’a dit qu’il y a un os qui s’est fragmenté au niveau de l’œil et qu’il fallait une intervention. Sinon, l’œil allait s’enfoncer dans l’orbite et j’allais le perdre », se
souvient-il.
Une nouvelle annonce des médecins plonge davantage Aziz Ouattara dans l’angoisse : il doit débourser plus de 2 millions F CFA pour son opération. Heureusement, son assurance santé couvre une partie des frais. Plus que l’argent, son unique préoccupation reste de recouvrer la vue. L’intervention chirurgicale se solde par un succès. Après deux mois, il recouvre progressivement l’usage de son œil, malgré des plaies persistantes et la perte de plusieurs dents remplacées par une prothèse. « Si j’avais porté au moins un casque, ça
m’aurait évité tout ça », regrette-t-il.
Un handicap à vie
Le cas de Aziz Ouattara, bien que dramatique, semble moins grave comparé à celui de Bapio Achille Bako. Début janvier 2012, alors élève en classe de 2nde à Gaoua, il est victime d’un grave accident de la route. Lancé à vive allure dans les artères de la ville, sans aucune protection, son engin finit sa course contre un arbre. Conduit au Centre hospitalier régional de Gaoua, le diagnostic des médecins tombe comme un couperet : cinq fractures aux membres inférieurs dont trois fermées à la cuisse droite, une fracture ouverte à la jambe droite et une autre fermée à la jambe gauche. Un véritable choc pour Bako, dont le pronostic vital est désormais engagé. Face à la gravité de son état, les médecins décident de le transférer au Centre hospitalier Souro Sanou (CHUSS) à Bobo-Dioulasso, où il restera 108 jours, pour des soins.
Durant cette épreuve, la famille Bako a dû mobiliser plus de 3 millions F CFA pour couvrir les soins et la rééducation. Outre cette saignée financière, l’accident a causé une perte d’une année scolaire pour Achille, qui a dû faire une année blanche avant de reprendre ses études en classe l’année suivante. Le traumatisme le plus important est l’invalidité qui en a résulté. Achille Bako souffre désormais d’un handicap moteur qui l’oblige à marcher avec des béquilles.
Un feu rouge brûlé, une vie brisée

Alors que l’histoire de Achille Bako illustre les conséquences de l’excès de vitesse, le drame vécu par Ablassé Patam elle, rappelle celles d’une seule seconde d’imprudence parce que ce qui devait être une simple course s’est transformée en un cauchemar permanent. En effet, le dimanche 1er décembre 2022, de retour du service, M. Patam se met à la recherche d’un restaurant pour dîner. Dans une intersection à Pissy, quartier populaire de Ouagadougou, il ignore un feu tricolore au rouge.
Un véhicule qui venait dans le sens inverse et ne pouvant pas éviter Ablassé Patam au risque de faire plus de victimes, le percute de plein fouet. La violence du choc a été telle que le chauffeur, le croyant mort, a pris la fuite. Avec un douloureux recul, Ablassé Patam confie aujourd’hui : « le casque a au moins sauvé ma tête de tout traumatisme ». S’il a échappé de justesse à la mort, sa jambe droite, par contre, a été complètement « broyée ». « Le troisième jour de mon accident, mon pied a commencé à se décomposer, puisque toutes les veines ont été sectionnées », se souvient-il, douloureusement.
Pour éviter une infection généralisée, l’amputation est devenue l’unique option. En perdant l’un de ses pieds, Ablassé Patam a également perdu son gagne-pain. Employé du Bâtiment et des travaux publics (BTP), un travail qui exige l’usage de ses deux jambes pour monter en hauteur, il se retrouve aujourd’hui sans emploi.
Marié et père de deux enfants, il est désormais confronté à la dure réalité des charges familiales et doit sa survie au seul soutien de sa famille. Dans le regret aujourd’hui, Ablassé Patam s’en veut d’avoir violé le Code de la route.
« Le mieux est de tout faire pour que l’accident ne t’arrive pas, sinon une fois que tu deviens handicapé, c’est toute ta vie qui est foutue », marmonne-t-il.
Le lourd prix d’un accident …
Une vie détruite, c’est l’impression que Mariam Zongo a désormais de son
existence. Jadis « grande » commerçante d’habits au marché de 10 yaar de Ouagadougou, elle est désormais « petite vendeuse de quartier». Sa vie a basculé le 30 novembre 2019. Alors qu’elle se rendait dans la capitale économique (Bobo-Dioulasso), à bord d’un car de transport en commun, l’impensable se produit : l’un des pneus du véhicule éclate aux encablures de Boromo. Lancé à vive allure, le car se renverse violemment et chute dans un pont. Le bilan de l’accident est lourd : plusieurs morts et de
nombreux blessés graves, dont Mariam.
« Les médecins ont dit qu’il fallait amputer mon bras gauche », se remémore-t-elle. Abandonnée par son époux avec leur fils de 4 ans, Mariam Zongo a pu compter sur le soutien de sa famille. Malgré la perte de son bras, la trentenaire a refusé de céder à la fatalité. Aujourd’hui, elle se reconstruit et refait sa vie auprès d’un homme qui ne voit pas son handicap comme un obstacle. Grâce à cet amour, Mariam réapprend à apprécier la vie. Mère de deux autres enfants, elle contribue aux dépenses de sa nouvelle famille, en vendant des chaussures dans son quartier. Pleine d’amertume, elle insiste sur son innocence dans ce drame et accuse le chauffeur d’excès de vitesse.
Des militants actifs

à l’ONASER, Nina Samé, s’est réjouie de l’augmentation du nombre
d’usagers qui portent le casque.
Aujourd’hui, Mariam Zongo est une militante active au sein de l’Association des
victimes d’accidents du Burkina Faso (AVABF). Elle se sert de son handicap
visible pour sensibiliser au respect du Code de la route, car, convaincue que la majorité des accidents au Burkina Faso peut être évitée. « Quand je leur parle, mon physique les contraint à m’écouter. Il y en a qui versent même des larmes », confie-t-elle. Son message, porté par sa propre histoire, est un puissant appel à la responsabilité des conducteurs.
Avec ses collègues de l’AVABF, Mariam s’emploie à sensibiliser les transporteurs en commun à la nécessité de respecter la réglementation en matière de vitesse. Elle déplore l’attitude de certains chauffeurs : « Ils se disent que puisque leur véhicule est assuré, tout leur est
permis car l’assurance prendra en charge le moindre problème ». Mais Mariam Zongo fait savoir que l’indemnisation de l’assurance n’est qu’un dédommagement, « souvent dérisoire » face aux préjudices irréversibles subis. « Moi par exemple, j’ai perdu mon bras. Quelle assurance peut me le ramener ? », lance-t-elle, émue.
Ablassé Patam, également engagé au sein de l’AVABF, utilise sa propre expérience d’accidenté pour sensibiliser les conducteurs. Il estime que son cas éveille les
consciences sur les dangers du non-respect du Code de la route. « Les gens ont besoin de voir pour croire », explique-t-il, affirmant qu’au vu de son cas, les gens se rendent compte que l’imprudence peut les mener à sa situation. Pour l’encourager dans ses missions, les responsables de l’association lui ont offert une prothèse, lui permettant désormais de se déplacer en motocyclette.
Sensibiliser par l’exemple
Bien qu’il soit toujours sans emploi et confronté à des difficultés financières, Ablassé Patam trouve son réconfort et sa joie dans l’aide aux autres. « Je suis convaincu que grâce à mon témoignage, beaucoup de gens ont évité des accidents et même la mort », se réjouit-il. Son engagement est devenu une force, transformant sa souffrance en un puissant outil de prévention.
Tout comme Mariam et Ablassé, Bapio Achille Bako et Aziz Ouattara sont aujourd’hui de véritables « ambassadeurs » du Code de la route. Militants au sein de l’association « Zéro goutte de sang sur la route » (ZGSR), ils parcourent villes et villages pour « propager le message » de la sécurité routière. Moumini Koudougou, président de l’association, apprécie leur contribution.

des réseaux sociaux un allié de sensibilisation.
« Comme ils ont été eux-mêmes victimes, leur histoire parle plus aux gens, lors des séances de sensibilisation », avoue-t-il. Du côté de l’AVABF, Ablassé et Mariam sont considérés comme des maillons essentiels de l’équipe de sensibilisation.
« Nous parcourons les villes et villages du Burkina ensemble pour la sensibilisation et ça porte fruit », soutient le président de la structure Zamanoma Kaboré. A titre d’exemple, l’AVABF a été sollicitée par le dirigeant d’une entreprise minière de la place. L’objectif était de sensibiliser ses employés, après une série d’accidents de la circulation.
A entendre Ablassé et Mariam, lorsqu’ils ont partagé leurs témoignages poignants, l’émotion était palpable : de nombreux agents ont versé des larmes. « Cette réaction n’a pas été que de la compassion. Les agents ont pris l’engagement ferme de respecter le Code de la route pour prévenir de futures tragédies. Cette démarche a eu un impact direct et significatif, entraînant une réduction drastique du nombre d’accidents au sein de l’entreprise », soutient Ablassé.
Les réseaux sociaux, un allié puissant
Si l’AVABF sensibilise plus sur le terrain, ZGSR a la particularité d’être active sur les réseaux sociaux. Née d’une page Facebook dénommée « Circulation de Ouaga », elle est devenue une association formelle en 2020. Selon M. Koudougou, la sensibilisation routière est un défi, car elle est perçue comme un sujet lassant qui n’attire pas l’attention du public. « C’est difficile de réunir les gens pour parler de sécurité routière, parce que c’est un sujet qui casse l’ambiance », souligne M. Koudougou. De ce fait, l’association a fait des réseaux sociaux son terrain de sensibilisation. Sur sa page Facebook, soutient son président, un message est posté toutes les cinq minutes, touchant au moins 500 000 personnes par publication.
Cela représente plus de 4 millions de personnes impactées chaque mois.
C’est vraiment notre force, car il serait impossible d’organiser une conférence pour réunir 500 000 membres », se convainc M. Koudougou. En plus des réseaux sociaux, certains grands évènements tels que le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) et le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) sont mis à profit par l’association pour la sensibilisation de proximité.
L’action de ces associations est appréciée à sa juste valeur par l’Office national de sécurité routière (ONASER) dont la sécurité routière constitue l’un des trois objectifs principaux. Selon la directrice de la planification et de la promotion de la sécurité routière à l’ONASER,
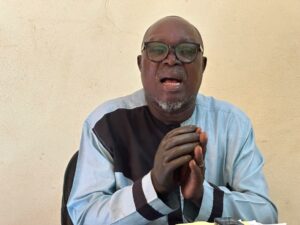
Burkina Faso, on soit obligé de forcer les gens à préserver leur propre vie ».
Nina Samé, la collaboration entre les différents acteurs est importante pour l’atteinte des objectifs en matière de sécurité routière. C’est pourquoi, l’ONASER, dit-elle, soutient financièrement et techniquement les activités de certaines associations qui se distinguent de manière significative dans le domaine. L’association ZGSR est ainsi devenue un allié stratégique de l’ONASER dans son combat contre l’insécurité routière. « Elle a l’avantage d’être représentée sur l’ensemble du territoire national », se réjouit Mme Samé.
L’excès de vitesse, un « cancer »
Selon le Pr Sayouba Tinto, orthopédiste traumatologue, chef de l’unité des urgences traumatologiques au Centre hospitalier universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo, les accidents de la circulation représentent 93% des circonstances de survenue de traumatismes chez les patients admis à son service. Et sur 100 accidents, 94% impliquent des conducteurs d’engins à deux roues. Le Pr Tinto déplore malheureusement des cas de plus en plus graves au fil des années. Et parmi ces cas graves, la principale cause de décès est le traumatisme crânien. Les explications possibles de cette situation, selon lui, restent l’excès de vitesse et le non-port du casque.
Aux dires du Pr Tinto, sur 100 personnes qui décèdent par traumatisme crânien suite à un accident de la circulation, 90% n’avaient pas porté de casque au moment de
l’accident. L’enseignant à l’université Joseph-Ki-Zerbo insiste sur la nécessité pour les usagers d’engins à deux roues de porter le casque pour préserver le crâne
des lésions. Mais, il est convaincu que le Burkina Faso est sur la bonne lancée grâce aux différentes initiatives qui sont développées par le gouvernement et les acteurs de la société civile.
Le président de l’association ZGSR est du même avis. Pour lui, des avancées ont été enregistrées en matière de promotion du port du casque. Parmi elles, il y a l’application effective de la loi portant obligation d’intégrer le casque aux équipements d’accompagnement des véhicules motorisés à deux roues lors de la vente. Il se réjouit qu’aujourd’hui, les motos soient systématiquement livrées avec des casques.
Toutefois, les acteurs sont unanimes que des défis demeurent car les chiffres restent préoccupants. Les statistiques de l’ONASER pour la période du 25 août au 25 septembre 2025 font état de 1 894 accidents constatés sur l’ensemble du territoire, avec pour
conséquence 1 395 blessés et 82 tués. La région du Kadiogo reste la plus touchée avec 1187 cas, 589 blessés et 28 tués.
Une seule vie perdue est de trop
Pour l’ONASER, une seule vie perdue lors d’un accident est de trop. Il y a donc
lieu, selon la directrice de la planification de la promotion de la sécurité routière, de renforcer la sensibilisation pour l’adoption des bons comportements en circulation. « A

Ouédraogo, Pr Sayouba Tinto, insiste sur la nécessité pour les usagers d’engins à deux roues de porter le casque pour préserver le crâne
des lésions.
notre niveau, nous pensons qu’il est important d’agir sur l’homme si l’on veut obtenir des résultats en matière de lutte contre les accidents de la circulation », soutient-elle. En misant sur l’homme, l’ONASER semble avoir adopté la bonne méthode.
Car selon le Pr Tinto, les causes humaines sont les plus fréquentes en matière d’accidents de la circulation. En plus des « tares » officiellement reconnues que sont le non-respect du Code de la route, l’excès de vitesse et le non port du casque, le chef de l’unité des urgences traumatologiques au CHU Yalgado Ouédraogo dénonce d’autres mauvais comportements à risques que sont l’imprudence, le manque de courtoisie, l’usage du téléphone en circulation, la fatigue, la conduite en état d’ivresse, etc. Même si
ces comportements sont récurrents sur les routes au Burkina, il n’y a pas lieu, selon Mme Samé, de baisser les bras.
« Les changements d’habitudes et de comportements sont toujours une lutte de longue haleine », pense-t-elle. Pour avoir le résultat attendu, il y a lieu d’investir dans la sensibilisation des plus jeunes. C’est pourquoi, une grande partie des activités de
sensibilisation de l’ONASER concerne cette frange de la population notamment les élèves et les étudiants.
Nadège YAMEOGO






Ensemble Zéro goutte de sang sur la route