
Au Burkina, des réfugiés, notamment des femmes, pratiquent l’agriculture pour assurer leur autonomisation et mieux s’intégrer au sein des communautés hôtes. Dans le village de Matourkou, situé à 15 kilomètres de Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, elles exploitent plus d’une centaine d’hectares. Là, réfugiées et hôtes vulnérables sèment et récoltent, ensemble, les germes de l’espoir …
Fin juillet 2025. A Matourkou, village situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, les cultures présentent une bonne physionomie. Les plants vigoureux, les feuillages verdoyants, la régularité et l’abondance des pluies laissent entrevoir une saison agricole prometteuse. Si dans certaines exploitations, les céréales et légumineuses ont atteint le stade de levée, ailleurs, elles sont au stade de semis. Chez d’autres encore, les labours sont toujours en cours. Mais partout, l’enthousiasme des producteurs est palpable, porté par la perspective de récoltes fructueuses.
La trentaine révolue, Fatoumata Ongoïnbo, mère de trois enfants, réfugiée malienne installée au quartier Farakan de Bobo-Dioulasso, exploite un demi-hectare. L’heure est au désherbage de son champ. En pagne coloré et foulard noué sur la tête, sa daba en main, elle débarrasse ses plants de maïs, des mauvaises herbes, en compagnie de son fils de 6 ans, habillé aux couleurs des Etalons. « Il me reste à répandre l’engrais pour booster leur croissance », indique-t-elle. En plus de cette spéculation, elle a emblavé du mil, de l’arachide et du niébé.
Désormais loin de son village natal de Koroma, région de Koulikoro au Mali, dame Ongoïnbo s’est forgé une nouvelle vie, dans les sillons de la terre. Devenue agricultrice depuis 2021, elle applique bien les techniques culturales. « Avant les premières pluies, nous
avons apporté de la fumure organique. Le sol est assez fertile. C’est ce qui explique la bonne allure du mil et du maïs », explique-t-elle, le regard tourné vers ses cultures vertes denses. Elle nourrit l’espoir d’une récolte abondante, gage de sécurité
alimentaire pour sa famille.
Comme elle, 172 personnes, dont 163 réfugiés et neuf membres des communautés hôtes, exploitent ce site agricole aménagé par le gouvernement burkinabè, à travers le Secrétariat permanent de la Commission nationale des réfugiés (SP/CONAREF), avec l’appui de ses partenaires, notamment le Haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR). Selon Dramane Koussoubé, associé à la protection au sein du SP/CONAREF, le
site compte 117 femmes et 55 hommes.

A l’échelle nationale, précise-t-il, sur plus de 10 400 ménages réfugiés installés au Burkina, plus de 60 % sont dirigés par des femmes. « La plupart de ces réfugiées vivaient déjà en milieu rural dans leurs pays d’origine, où elles pratiquaient l’agriculture. C’est en 2021 que nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce projet afin de les soulager, en leur offrant une activité génératrice de revenus et un moyen de renforcer leur autonomie », explique M. Koussoubé.
« On se noyait et le Burkina nous a tendu la main »
Formées et encadrés par l’Ecole nationale de formation agricole (ENAFA), ces réfugiées mettent en valeur 105 hectares, dont 100 hectares de cultures céréalières et 5 hectares réservés à la culture de légumineuses et à la pisciculture. Chaque bénéficiaire exploite un demi-hectare. Sur ces terres, plusieurs spéculations comme le maïs, le niébé, l’arachide, le mil, la laitue, le chou, l’aubergine, la tomate et l’oseille sont produites.
Foulard vissé sur la tête, Salimata Goro, 43 ans, en T-shirt rose et pagne orange orné de motifs colorés, arrache les herbes aux pieds de ses arachides. Aujourd’hui, elle a fait appel à deux dames pour désherber son champ, moyennant la somme de
1 000 F CFA chacune.
Venue de Dinangourou, dans la région de Bandiagara au Centre du Mali, elle dit nourrir sa famille de sept personnes, grâce aux récoltes issues de son lopin de terre à Matourkou. « Ce champ représente tout pour nous. Il me permet de nourrir ma famille. C’est une bouée de sauvetage. On se noyait et le Burkina nous a tendu la main », affirme-t-elle, la voix teintée de reconnaissance. Salimata confie que l’ensemble de sa production agricole est réservée à la consommation familiale.
« Nous ne vendons rien de ce que nous récoltons. Depuis la fin de la dernière saison agricole, c’est ce que nous consommons jusqu’à présent », indique-t-elle. Pour la campagne en cours, elle a emblavé du maïs, du niébé et du voandzou (pois de terre). Ces jeunes pousses, d’un vert prometteur, incarnent l’espoir d’une famille qui, pendant longtemps, a dû compter sur l’assistance humanitaire pour survivre.

A un jet de pierre de sa parcelle, s’étend celle de sa compatriote, Fanta Goro. Originaire de Douenza, localité située dans la région de Mopti au Mali, elle s’est installée au quartier Accart-Ville de la capitale économique. Au départ, elle s’était lancée dans la vente de charbon et la lessive dans les domiciles pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais depuis quelques années, se souvient-elle, sa vie a progressivement changé grâce à l’agriculture.
Chaque jour, sauf le vendredi, la quinquagénaire prend le bus ou un taxi-moto pour rejoindre son champ à Matourkou, devenu son principal moyen de subsistance. Agricultrice chevronnée, elle a mis du haricot entre les pieds de maïs. Sa propriété présente une belle allure, malgré l’existence de quelques hautes herbes. « Comme les plants de maïs grandissent en hauteur et sont espacés l’un de l’autre, nous semons du niébé entre ses pieds. Une autre partie du champ est réservée pour le gombo et l’oseille », explique la « vieille » Fanta.
Avec fierté, elle assure que les récoltes de sa petite exploitation suffisent à nourrir sa famille pendant plusieurs mois, réduisant ainsi sa dépendance de l’aide extérieure. « L’alimentation est notre principale préoccupation. Pour cuisiner, il me faut au moins deux boites de farine de maïs, alors que la boite coûte au moins 500 F CFA. Grâce aux activités que nous menons ici, nous ne payons plus de farine de maïs », se réjouit Fanta Goro.
Réduire sa dépendance de l’aide humanitaire
En 2024, le bureau régional du HCR, basé à Bobo-Dioulasso, a mené une
évaluation auprès de 50 producteurs du site agricole de Matourkou. Il ressort que 50 % des enquêtés couvrent leurs besoins alimentaires pendant 6 à 7 mois, 30 % entre 8 à 9 mois, 15 % jusqu’à 12 mois et 5 % sont autonomes sur plus d’un an.

de l’aide humanitaire.
L’activité agricole a donc permis à de nombreuses familles de réfugiés de réduire leur dépendance de l’aide humanitaire. « C’est une avancée importante vers l’autosuffisance alimentaire », assurent les rapporteurs. Grâce au maïs, au mil, au niébé … récoltés sur le site aménagé de Matourkou, les femmes refugiées parviennent à améliorer leurs conditions de vie. Lorsque Fatoumata Goro est arrivée dans l’Ouest du Burkina en 2012, avec ses six enfants, l’un de ses soucis a été de parvenir à nourrir sa progéniture.
Au quartier Diarradougou, elle enchaîne les petits boulots ménagers dans les environs. « A notre arrivée, nous dépendions uniquement de l’aide humanitaire et des bonne volontés. Il fallait qu’on nous tende la main à chaque fois pour que nous puissions manger », se souvient-elle. Mais rapidement, elle réalise que la terre peut être sa voie de résilience. Treize années plus tard, Fatoumata estime avec fierté avoir franchi un cap : passer de la survie à l’autonomie grâce à l’agriculture. Dame Fatoumata « s’est révélée ». Grâce à son lopin de terre, elle parvient aujourd’hui à nourrir sa famille sans tendre la main.
Sa situation économique s’est stabilisée. Sa condition de vie, améliorée. « Depuis l’année dernière, nous n’avons payé aucun gramme de maïs», renchérit-elle. Au terme de la précédente saison agricole, elle a pu récolter près de 15 tines, soit plus 250 kilogrammes de maïs. « Nous achetons souvent du riz, des tubercules, des pâtes alimentaires … pour varier notre alimentation. Mais l’essentiel de notre nourriture provient de ce champ », indique Fatoumata Goro.
En tenue traditionnelle aux couleurs vives, avec un motif tie-and-dye en forme circulaire au centre, assorti d’un foulard et portant des lunettes de soleil, Naoudaïngar Christiane Ouattara, réfugiée tchadienne, a aussi su tirer profit des opportunités offertes par le site agricole de Matourkou.
Des revenus supplémentaires
En plus de sa parcelle de culture pluviale, elle exploite un périmètre maraîcher, aménagé dans la même zone. Une activité complémentaire qui lui permet non seulement de diversifier sa production, mais aussi de générer des revenus réguliers. L’oseille, l’épinard, la tomate et le gombo qu’elle produit en contre-saison, contribuent à enrichir l’alimentation de sa famille. Les céréales du champ et les légumineuses du jardin lui ont permis d’améliorer la valeur nutritionnelle des repas des Ouattara, avoue-t-elle. Aussi, poursuit-elle, la revente des condiments lui permet d’avoir des revenus supplémentaires.
« En plus d’avoir suffisamment de légumes pour notre consommation, nous avons un surplus que nous vendons sur le marché. Nous pouvons avoir entre 10 000 et 40 000 F CFA par semaine », confie-t-elle. Ces revenus, foi de Mme Ouattara, contribuent à scolariser et à offrir de meilleurs soins de santé à ses enfants.
Les moments de précarité et de faim, jadis des défis quotidiens, sont désormais révolus dans cette famille de cinq personnes. « Maintenant, nous mangeons à notre faim. En plus, nous gagnons un peu d’argent grâce à ce champ », lâche-t-elle avec un brin de fierté.
« Elles ne sont plus un fardeau »

nourrit convenablement sa famille grace aux récoltes issues de son lopin de terre.
L’évaluation menée en 2024 par le HCR-Burkina auprès de 50 producteurs de ce site a aussi révélé que les revenus générés varient entre 20 000 et 132 500 F CFA par trimestre. « Cela leur permet de se nourrir, de s’habiller, de scolariser leurs enfants, de payer leur loyer et même d’investir dans des terres », peut-on lire dans le rapport.
Pour Dramane Koussoubé, le site agricole des réfugiés de Matourkou incarne un véritable modèle de résilience.
« Grâce à l’agriculture, les bénéficiaires ne dépendent plus de l’assistance humanitaire. Elles ne sont plus un fardeau », se réjouit-il. Au-delà de la production vivrière, l’initiative favorise, selon lui, l’autonomisation économique des femmes réfugiées. Ce site leur garantit un accès à une alimentation saine et équilibrée, tout en leur offrant la possibilité de vendre une partie des récoltes pour couvrir certaines dépenses, souligne M. Koussoubé. En dépensant moins d’argent dans l’achat de nourriture, estime M. Koussoubé, les femmes peuvent dégager des revenus supplémentaires qui seront réinvestis dans d’autres domaines comme l’éducation des enfants, la santé, le commerce, etc.
Restaurerla dignité des réfugiées
Depuis 2021, dans la région du Guiriko, plusieurs femmes réfugiées ont su transformer leur quotidien grâce à l’agriculture. Non seulement, elles parviennent à nourrir convenablement leurs familles, mais elles réussissent également à générer des revenus. Fatoumata Oualatou est l’une d’elle. Une houe posée sur l’épaule gauche et habillée en complet estampillé « 8-Mars. Journée internationale de la femme », la présidente des femmes réfugiées de Bobo-Dioulasso se réjouit d’avoir tourné la page des nuits blanches liées aux difficultés alimentaires.
Aujourd’hui, grâce à son champ d’un demi-hectare, elle affirme être autonome et capable de subvenir aux besoins essentiels de son foyer. « C’est très bénéfique. Jusqu’aujourd’hui, nous consommons ce que nous avons récolté l’année dernière. Les arachides récoltées sont souvent transformées en pâte pour la sauce », détaille Fatoumata Oualatou. Elle pense que le site agricole de Matourkou a permis de restaurer un tant soit peu, la dignité des refugiées. « Nous sommes beaucoup plus respectées, parce que nous ne sommes plus obligées de quémander la nourriture », argue Mme Oualatou.
Intégration, cohésion sociale et paix

De son côté, Ali Sawadogo, associé à la protection au sein du bureau HCR de Bobo-Dioulasso, précise que le site agricole de Matourkou est un pari gagnant. Car, il vise d’abord à favoriser l’autonomisation économique des réfugiées, en leur assurant un revenu décent à travers l’agriculture. Ensuite, ajoute-il, cela permet d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages, car une partie des récoltes est consommée et le reste monnayé. « 172 ménages bénéficient directement de ce site.
Ils peuvent subvenir aux besoins de leurs familles, scolariser leurs enfants, accéder à des soins de santé, et même développer des activités économiques annexes comme le com-
merce », détaille M. Sawadogo. Il affiche une « assez grande satisfaction », car fait-t-il savoir, si les femmes réfugiées sont économiquement autonomes, ce sont leurs familles qui seront épanouies. Au-delà de son rôle dans l’autonomisation économique, le site agricole de Matourkou favorise l’intégration sociale des réfugiés au sein des communautés locales.
Véritable lieu de transformation des destins, il est aussi un espace de solidarité où réfugiés et populations hôtes vulnérables unissent leurs forces contre l’insécurité alimentaire. « Nous travaillons nos terres, main dans la main, pour booter la faim hors de nos ménages. Ici, c’est la solidarité, l’entraide, la fraternité », soutient Aminata Traoré, réfugiée malienne résidant au quartier Diarradougou de la ville de Sya.
Pour elle, le simple fait d’avoir accès à une parcelle de terre cultivable symbolise une véritable intégration au sein des communautés burkinabè. Comme preuve de la générosité de ses hôtes de Matourkou, elle témoigne :
« Cette année, mon voisin de champ, un Burkinabè, m’a offert gracieusement des semences de maïs et de haricot ».
L’une des spécificités de la région du Guiriko réside dans le mode d’accueil des réfugiées, foi de Ali Sawadogo. « Ici, elles vivent au sein des quartiers urbains, en location ou hébergés par des familles burkinabè. Elles ne sont pas dans des camps. Ce qui favorise une meilleure inclusion dans la vie communautaire. Aussi, je pense que c’est un facteur de promotion de paix. Les gens se côtoient, échangent, partagent leurs peines et joies et s’entraident au quotidien », estime-t-il.
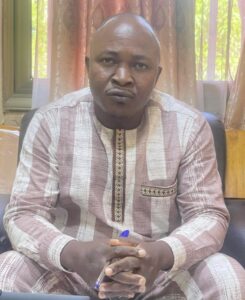
réfugiées.
Cette cohabitation pacifique crée de nouveaux liens, comme le reconnait Joceline Sanou, membre de la communauté hôte à Bobo-Dioulasso. La cinquantaine, elle avoue que les interactions quotidiennes avec les femmes réfugiées, que ce soit en ville ou dans les champs de Matourkou, ont changé son regard. « Etre forcé de quitter chez soi peut arriver à tout le monde.
C’est une situation très difficile. C’est pourquoi, nous nous tendons la main. Aujourd’hui, nous formons une famille. Chacun cherche à nourrir sa famille », souligne-t-elle.
Pour Dramane Koussoubé, le site agricole de Matourkou représente un exemple concret de ce qu’il est possible de faire en matière d’inclusion et de cohésion sociale
entre réfugiés et membres vulnérables de la communauté hôte au Burkina. Il y voit un modèle à dupliquer dans d’autres localités accueillant des populations réfugiées.
« Grace aux activités menées sur le site agricole, les réfugiées gagnent dignement leur vie. Cela évite qu’elles posent des actes répréhensibles qui puissent compromettre la paix et la cohésion sociale », ajoute M. Koussoubé.
Selon lui, nombreux sont les réfugiés qui souhaitent accéder à la terre afin de pratiquer des activités agricoles, gage d’autonomie et de dignité. Cependant, il pointe du doigt l’un des principaux obstacles à cette ambition, la question foncière. M. Koussoubé plaide en faveur d’une meilleure intégration des réfugiés, en particulier des femmes, dans les initiatives agricoles nationales, notamment dans le cadre de l’Offensive agricole en cours.
Une telle inclusion, souligne-t-il, permettrait non seulement de valoriser le potentiel agricole des réfugiés, mais aussi de réduire les dépenses publiques liées à leur prise
en charge. Assurer elle-même les besoins alimentaires de son ménage, c’est aussi le défi que relève chaque jour, Mariam Diallo. Installée à Bobo-Dioulasso depuis 2023, elle dépendait au départ de l’aide humanitaire. Mais cette année 2025 a marqué un tournant. Pour la première fois, elle a eu accès à une parcelle de terre à cultiver. Aujourd’hui, elle se dit engagée sur une nouvelle voie, celle de l’autonomie par l’agriculture.
Sur son lopin, elle a semé du mil, du haricot et de l’arachide. Pour Mariam Diallo, cette terre représente bien plus qu’un simple champ : c’est une bouffée d’espoir, un moyen concret de rompre avec la précarité et de reconstruire une vie digne, loin des incertitudes.
Djakaridia SIRIBIE
dsiribie15@gmail.com
Les réfugiés en chiffres…
Au 30 septembre 2025, le Burkina Faso accueille plus de 41 979 réfugiés, selon le Secrétariat permanent de la Commission nationale des éfugiés (SP/CONAREF). Soit 26% de femmes et 25% d’enfants. Ils sont répartis dans 10 474 ménages dont 60%, dirigés par des femmes. Les chiffres du SP/CONASUR, corroborés par le HCR-Burkina, montrent que 96% de réfugiés vient du Mali. Selon les données actualisées de HCR, d’avril 2025, on compte 4 316 réfugiés et demandeurs d’asile dans la région du Guiriko.
La main tendue de l’ENAFA
Au terme d’une convention avec le HCR-Burkina, l’Ecole nationale de formation agricole (ENAFA) a cédé, au départ, 60 hectares de ses terres. Vu l’engouement et le nombre croissant des réfugiés, elle a
augmenté les superficies à 105 hectares. En plus de donner « gracieusement la terre », l’ENAFA leur offre un appui matériel et technique. Elle laboure les champs, offre les alevins pour la pisciculture …
« Nous les encadrons et faisons un suivi rapproché pour leur permettre de rentabiliser leurs exploitations agricoles », explique Hamidou Sankara de l’ENAFA.
Plus de camps de réfugiés au Burkina
Il n’existe plus de camps de réfugiés au Burkina Faso depuis 2021, rassure le
Secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés (SP/CONAREF). Les derniers en date étaient ceux de Goudebo et de Menao.
Suite à la crise sécuritaire, les camps se sont vidés. Les réfugiés ont rejoint les centres urbains. L’Etat burkinabè a donc acté la
fermeture définitive des camps de réfugiés au Burkina Faso.
D. S





