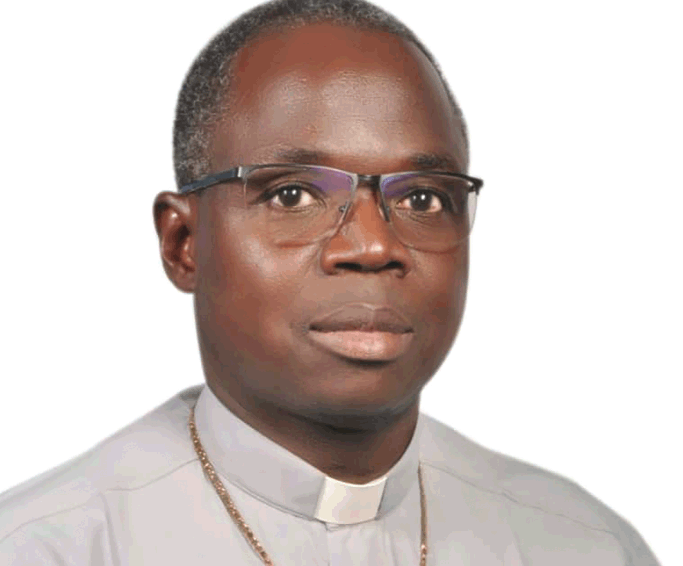
Chaque année, l’imposition des cendres le mercredi, dit des cendres, marque le début du carême et sonne comme un appel retentissant à la conversion. Se convertir, en gros, c’est « se détourner du mal afin de se tourner résolument vers le Bien, Dieu en définitive. Il s’agit de reprendre la voie (du Bien) dont on s’était écarté ; en somme, se détourner de ses péchés, ou y renoncer” afin de s’améliorer, par rapport à Dieu, aux autres et même à soi-même. Dans ce sens, le mot conversion en général, signifie se tourner vers Dieu.
Le mercredi des Cendres que nous avons vécu le 2 mars 2022, a ouvert le temps de carême en nous rappelant que sans le souffle de vie de Dieu, hors de son amour, notre être et notre vie ne sont que poussière. L’une des formules d’imposition des cendres utilisée par le prêtre en imposant les cendres le dit expressément d’ailleurs : « tu es poussière et tu retourneras à la poussière » (Gn 3, 19).
Ainsi en recevant les cendres, nous reconnaissons que parfois, nous faisons le mal plutôt que le bien. Le mal ainsi réduit en cendre nous laisse place et même favorise son remplacement par le Bien. Il est donc clair que l’imposition des cendres est un geste de conversion, un désir manifeste d’amélioration, une acceptation de Dieu dans notre vie. Ce geste d’imposition des cendres rappelle la condition humaine marquée par ses limites physiques et spatio-temporelles.
Et c’est plutôt un chemin de recherche et de progression. Nous sommes alors invités durant quarante jours, par les moyens concrets que le Christ nous a donnés – le jeûne, la prière et le partage – à tourner le dos à tout ce qui conduit à la mort et à nous tourner (c’est la conversion) vers la source de la vie, de l’amour et de la lumière : Le Christ ressuscité dont le cœur, ouvert sur la croix, est cette source.
Le temps du Carême permet aux catéchumènes de se préparer à recevoir le baptême lors de la nuit de Pâques et à chaque chrétien de vivre davantage du baptême reçu. Revenons donc un instant sur les moyens concrets que nous propose l’Eglise pour vivre ces quarante jours de manière à parvenir à Pâques, transfigurés :
• Le jeûne
C’est l’un des marqueurs obvie du carême. D’ailleurs, il est intéressant de faire remarquer que toutes les religions ont en commun cette pratique ascétique. Aujourd’hui, il est même un moyen pacifique souvent employé pour dénoncer énergiquement une injustice, et on parle alors de grève de la faim. Pour le chrétien, le jeûne qui plait à Dieu, est connu dès l’ancien testament où le prophète Isaïe par exemple s’en prend au jeûne qui sert à camoufler de graves injustices sociales.
Sans le respect de la justice et le secours apporté aux pauvres, les pratiques rituelles ne peuvent honorer Dieu. Car il n’a que faire de rites sans signification et vides de sens. Là-dessus, les paroles du prophète sont claires et nettes : « le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ?
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi, marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. » (Is 58, 6-9) Tout en réveillant en nous le sens des limites, le jeûne nous ouvre aux autres, et au tout autre, nous donnant ainsi de retrouver la saveur des relations avec eux.
• La prière
En nous donnant de bien maitriser nos multiples avidités pouvant concerner aussi bien la nourriture que d’autres lieux tels les écrans, les réseaux sociaux, les jeux, ou diverses autres addictions, le jeûne nous ouvre à la prière, temps gratuit donné au Seigneur pour lui présenter le monde, l’Eglise, ceux et celles qui souffrent ou se sentent exclus, isolés. Toutes les activités chronophages nous laissent alors le temps à la rencontre avec Dieu et le prochain, de sorte que ‘‘notre prière devienne action et notre action, prière’’.
• Le partage
On parle aujourd’hui volontiers de partage, voire de compassion, qui sans doute passent mieux que aumône qui semble avoir pris un air condescendant. Et pourtant, dans l’enseignement de Jésus qu’on lit le mercredi des cendres (Mt 6,1-18), l’aumône arrive en premier, avant la prière et le jeûne. Et si la Bible la préfère telle quelle, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un sentiment, comme la miséricorde, mais d’une exigence sociale, matérielle et spirituelle.
L’aumône au sens biblique, c’est apporter l’aide au nécessiteux de manière à ce que celui-ci puisse devenir autonome et se passer ainsi de votre aide. A défaut, la dignité du bénéficiaire doit être sauvegardée. On sait bien, en effet, qu’il peut y avoir une utilisation perverse de la charité, lorsque le don devient un moyen pour le donateur d’affirmer sa supériorité sur le bénéficiaire, ou de se glorifier lui-même à peu de frais.
Jésus ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme : « Toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret » (Mt 6,3-4). Et ne croyez pas qu’il s’agit d’une image dépassée … C’est pourquoi le carême, chaque année, constitue bien un temps de grâce et une occasion propice d’un demi-tour existentiel vers Dieu qui s’inscrit dans la durée.
Il s’agit de nous laisser pétrir par la Parole de Dieu pour aborder les choses de la vie avec un esprit différent. Le jeûne, la prière, l’aumône doivent permettre au Seigneur de « créer en nous un cœur pur…, un esprit nouveau » (Psaume 51, 12). En cela, le carême est un temps d’appel insistant à la sainteté !
Abbé Paul DAH





