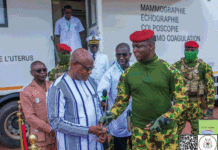Dr Sampawendé Jules Tapsoba est un brillant économiste du Fonds monétaire international (FMI) depuis une dizaine d’années. Il est par ailleurs représentant-résident du FMI au Togo depuis 2017. De passage au pays natal, Sidwaya s’est entretenu avec lui, le 15 juillet 2020, sur des sujets d’actualité nationale et africaine.
Sidwaya (S) : Comment se porte le monde aujourd’hui sur le plan financier, dans un contexte de COVID-19 ?
Dr Sampawendé Jules Tapsoba (S.J. T) : La maladie à coronavirus a mis à l’arrêt l’économie et la finance mondiales. De mémoire d’homme, il y a longtemps que l’on n’avait pas vécu pareille situation. Outre ses conséquences sanitaires dramatiques, sur le plan économique, bon nombre de pays sont au bord de la récession. En Europe, on prévoit une récession de moins 10,2 % en 2020, avec une projection de rebond de 6% en 2021. D’une manière globale, il y aurait un recul de la croissance de l’ordre de 4,9%.
S: Quelle analyse faites-vous de l’impact de la pandémie sur les économies africaines, particulièrement celle du Burkina?
S.J.T: Sur le plan sanitaire, l’Afrique est restée résiliente ; il n’y a pas eu l’hécatombe annoncée par certains érudits du domaine. Mais au niveau économique, étant arrimée à l’économie mondiale, elle est très touchée. Sa croissance va être revue à la
baisse. Pour la première fois depuis deux décennies, l’Afrique va entrer en récession. La forte croissance de ces dernières années baissera pour être négative à -3,2%.
Pour le Burkina, le régime de croissance de 6% à 7% des dix dernières années va dégringoler autour de 1%. Dans notre pays, on est actuellement en train d’absorber l’impact de la COVID-19. On a eu deux phases. Au début de la pandémie, mars/mi-avril, il y a eu un décrochage sérieux de l’économie, au regard des indicateurs de fréquentation des commerces qui ont chuté d’environ un tiers. Des indicateurs de croissance montrent également un taux négatif entre mars et avril. En mai-juin, on a assisté à un certain retour à la normale. Dans le moyen terme, il y aurait une reprise dans deux, trois ans.
Mais il faudrait voir comment les économies européenne, américaine, chinoise vont remonter. La pandémie n’a fait que mettre en exergue nos faiblesses structurelles. Il ne faudra pas gérer la crise d’une manière transitoire en pensant que la COVID-19 a soulevé des problèmes passagers. Les Etats africains doivent repenser leurs politiques économiques, refonder leurs économies. Ils doivent chercher à comprendre ce qui fait lorsque le monde se ferme, les économies africaines n’arrivent pas à s’en sortir. La preuve, ils ont eu des difficultés à confiner leurs populations! Le continent doit rediriger ses structures économiques vers des leviers intérieurs.
S: Comment sortir de la prédominance du secteur informel dans les économies africaines?
S. J. T : Il n’y pas de solution magique. Il faut mettre d’abord l’accent sur la numérisation pour assouplir et simplifier les formalités et procédures lorsque le secteur privé interagit avec l’administration. Aujourd’hui, il est difficile pour une économie qui n’est pas digitalisée de prospérer! Alors qu’avec le coût actuel de l’internet dans notre pays, il est difficile de créer. L’amélioration de la qualité de l’internet est une dimension-clé du développement. C’est aussi une question de gouvernance et de communication pour montrer au secteur informel qu’il a intérêt à payer l’impôt, au lieu de frauder.
Il faudrait aussi encourager ceux qui viennent dans le formel, à travers des mécanismes d’incitation. Le foncier constitue également un élément à prendre en compte. Beaucoup d’acteurs informels utilisent le foncier mais n’ont pas les documents leur permettant de se formaliser. On pourrait imaginer une accélération de la modernisation de l’acquisition des titres fonciers pour persuader ces derniers à recourir au système bancaire, et par conséquent à se formaliser.
S : En tant qu’économiste, les plans de riposte des pays de l’UEMOA vous semblent-ils pertinents?
S. J. T: Chaque plan de riposte pris dans son contexte spécifique est adapté, chaque pays procédant en fonction des espaces budgétaires à sa disposition et des différentes aides reçues des institutions internationales. Seul bémol, l’efficacité de la réponse sociale. On a demandé à nos compatriotes de se confiner mais en contrepartie, il a manqué un système de filets sociaux pour répondre immédiatement à leurs besoins vitaux. Cela a placé les décideurs politiques face à un choix cornélien entre l’urgence de mettre l’activité économique à l’arrêt pour préserver la santé et donner aux citoyens les moyens de subsistance.
Par exemple, le Togo a rapidement lancé un système de solidarité intérieure qui est un mécanisme de transfert monétaire direct, appelé « Novissi ». Deux semaines après le couvre-feu, l’Etat a commencé à transférer directement de l’argent aux différents ménages à partir de mobile money. A partir de la carte de pauvreté et de la carte d’électeur, l’Etat savait qui était éligible.
Chaque deux semaines, il transférait 5000 F ou 6000F aux ménages pour tout juste la nourriture ; les femmes en recevaient plus. Des segments de métiers très affectés comme les taxis-motos et bien d’autres, ont été les cibles. En trois mois, le programme a coûté environ 18 milliards FCFA. Au niveau de certains Etats de la région, il a manqué cette réactivité sociale.
S : Quelles autres critiques peut-on faire à ces plans de riposte ?
S. J. T: Dans l’ensemble, les réponses sont adéquates en fonction des moyens. On peut en revanche s’interroger sur leurs qualité et efficacité. Il aurait fallu avoir très rapidement des déclinaisons, au niveau social et du sauvetage des entreprises car certaines ont fermé et il est difficile pour d’autres de survivre. On devrait avoir un système économique très alerte et ne pas attendre que les crises surviennent.
L’expérience togolaise de transfert monétaire « Novissi » est une solution novatrice que l’on pourrait dupliquer au Burkina Faso, notamment en faveur des déplacés internes, des plus pauvres. Ce modèle permet de créer une chaîne de solidarité entre l’Etat et les citoyens. Les plus pauvres qui sont au bord de la survie ne demandent pas beaucoup et l’Etat peut se le permettre.
La dernière critique à l’égard des différents plans de réponse est que nous sommes une union monétaire et économique mais il n’y a pas eu une réponse régionale coordonnée. L’Europe a un projet d’émission d’une dette commune pour faire des investissements dans les zones touchées par le coronavirus. Il n’y a pas de honte à copier ce qui est bien ailleurs.
S : Le FMI a décidé en avril dernier de l’allègement de la dette de 25 pays africains, dont le Burkina Faso. Le G20 était également dans cette dynamique. Au-delà de l’allègement, certaines voix demandent l’annulation pure et simple de la dette de l’Afrique. Cette revendication est-elle fondée?
S. J. T: La dette du continent pose toujours un débat sempiternel. On se souvient encore du discours historique de feu président Thomas Sankara à l’OUA demandant l’annulation de la dette! Toutes les positions sont légitimes. Au FMI, dans le cadre de la maladie à coronavirus, 102 pays ont demandé un financement urgent pour un paquet de 100 milliards de dollars ; ce qui a été fait.
En même temps, pour les pays pauvres, le FMI a décidé d’annuler le paiement du service de la dette de 2020 pour 29 pays. Cela crée de l’espace budgétaire car la dette qui devrait être payée cette année est reportée à l’année prochaine. Les pays comme le Burkina qui étaient sous-programme FMI depuis longtemps ont bénéficié d’un allègement de l’ordre de 20 à 30 milliards. Le G20 a fait un moratoire, qui veut dire que l’on décale le payement, c’est une suspension et non une annulation ! Il revient à chaque créancier de signer un accord bilatéral avec le pays concerné sur les modalités pratiques. Le principe est le même : trouver de l’espace budgétaire pour les pays éligibles !
S’agissant de la philosophie de la dette, lorsque l’on la contracte, à terme, on doit rembourser ; car c’est l’épargne d’autrui. Soutenir le contraire, pose un problème d’éthique internationale mais aussi du sort des engagements futurs avec la finance internationale. Un pays qui refuse de payer sa dette sera considéré comme un pays en défaut de paiement. Lorsque ce dernier sera en déficit d’épargne, aucun investisseur ne sera disposé à lui donner encore de l’argent pour sa relance.
Il y a eu cependant des initiatives d’annulation de la dette de la part des créanciers qui les ont décidées volontairement, en contrepartie des réformes. Des pays africains font un plaidoyer pour l’annulation de la dette, par contre d’autres sont contre l’annulation. La différence entre ces deux positions est qu’il y a des Etats qui veulent aller sur le marché financier pour capter des financements internationaux; et d’autres pensent qu’avec l’allègement du poids de la dette, ils pourront se re-endetter. Le meilleur moyen de ne pas s’endetter c’est de mobiliser conséquemment des ressources à l’interne.
S : La Chine détient à elle seule environ 40% de la dette africaine. Est-elle disposée à aller dans le sens de l’annulation de la dette du continent ?
S.J.T: La composition de la dette africaine a changé. Il y a dix, quinze ans, nous étions plus endettés vis-à-vis de la zone Euro, du G7, etc. Aujourd’hui, ce sont les pays émergents comme la Chine, l’Inde et autres qui sont devenus nos principaux créanciers. Toute solution de dette ne peut pas se faire sans eux. Avec la Chine, il existe des solutions variées. Des pays comme la Zambie ont vu certains de leurs actifs repris par la Chine.
Il y a eu des accords en nature contre la dette ; d’autres pays ont demandé à payer. Mais la Chine devrait faire des efforts. Cette crise financière nous enseigne une leçon : lorsque l’on prend une dette, il faudrait investir dans les secteurs productifs. Des Etats se sont endettés parce qu’il y avait de l’argent facile ; mais quand on prend de l’argent facile, à un moment de l’histoire, il faudra y faire face !
S : Comment le continent peut-il sortir du piège de l’endettement continu?
S. J. T: Il n’y pas de piège de l’endettement. Le seul piège qui vaille est d’utiliser à mauvais escient la dette ou lorsque vous ne collectez pas assez de ressources pour honorer les échéances de remboursement. L’endettement réfléchi, pertinent est nécessaire pour financer le développement. L’Afrique est au début de son développement et n’a forcément pas les ressources nécessaires pour réaliser les infrastructures structurantes qu’elle veut. La question, c’est comment s’endetter sans mettre à mal la viabilité de la dette.
Il faudrait éviter qu’une part importante des recettes mobilisées soit utilisée pour payer la dette. Les citoyens africains doivent apprendre à payer l’impôt, qui fait fonctionner l’Etat. Au Burkina Faso, le taux de pression fiscale tourne autour de 17-18% alors qu’en Europe, il avoisine les 40%. On doit aller vers de nouvelles niches fiscales. Il y a beaucoup de marges de manœuvre à faire.
S : La crise de la COVID-19 a une fois de plus, révélé l’urgence pour l’Afrique de repenser son développement. Comment doit-elle s’y prendre ?

des ressources à l’interne.
S. J. T: Elle doit reprendre les solutions qui existent, connues de tous, et s’y mettre. Le développement en Afrique, et partant du Burkina Faso, souffre d’une crise de gouvernance. Quand l’argent public est mal géré, le service public en pâtit et le citoyen lambda ne se sent pas redevable envers l’Etat. A cause des dysfonctionnements de l’économie comme la corruption, l’absence de process clair entre autres, même les stratégies les mieux élaborées deviennent inopérantes. Deuxièmement, nous avons une population jeune avec un système sanitaire très en retard.
On a vu comment avec la COVID-19 tout le monde courrait à la recherche des respirateurs, des centres d’accueil. On ne peut pas comprendre qu’après 60 ans d’indépendance, il n’y ait pas de centres pour recevoir les malades d’une telle pandémie ! L’investissement dans le capital humain (santé, éducation) devrait être très primordial pour nos Etats. Il en est de même pour la sécurisation des territoires. Actuellement, beaucoup d’Etats africains n’ont pas la maîtrise de leurs territoires. Le développement est fortement tributaire de la maîtrise du territoire.
On a souvent des territoires très vastes mais l’Etat n’y investit pas toujours. Construire des Etats-Nations, c’est être également très présent sur tout l’espace territorial. En matière de politique économique, il faudrait penser à remettre l’Afrique sur des leviers intérieurs de croissance et miser sur nos avantages comparatifs. Nous avons des économies un peu extraverties. Au niveau de la géographie, le Burkina Faso a, par exemple, une centralité en Afrique de l’Ouest. Comment convertir cette centralité en un avantage économique, et faire de notre pays un passage obligé dans la région? Au regard de cette position avantageuse, le Burkina Faso devrait être un champion dans l’intégration ; on l’est déjà, mais il faudrait une vision claire pour définir notre rôle dans cette centralité géographique.
Il importe également de savoir qu’aucun Etat ne peut se développer sans un secteur privé fort. Mais que faire pour que du secteur privé, des champions nationaux émergent ? Faciliter l’accès aux crédits, créer des politiques par paliers pour faire naître des capitaines d’industries constituent par exemple des alternatives. Certes, nous avons le coton, l’or mais il y a des avantages comparatifs qui se construisent dans le temps. Le Burkina Faso est l’un des rares pays où les gens quittent presque le secteur informel ou d’autres pour celui bancaire ; on en a trois aujourd’hui ! Notre pays est l’un des rares où des entrepreneurs peuvent se déporter dans d’autres Etats pour réaliser de gros chantiers!
Le Burkina Faso est l’un des rares pays où des nationaux sont dans le secteur de la téléphonie ! Tout cela témoigne que notre secteur privé a du génie. L’Etat pourrait organiser les états généraux du secteur privé pour permettre au privé de mieux contribuer au développement ! Nous avons beaucoup d’acteurs dans l’informel mais parmi cette pléthore, des capitaines ont émergé, tels que les grands cimentiers. Les stratégies de développement en Afrique souffrent de la multiplicité de leurs objectifs. Le PNDES a cinq, six objectifs.
Quand on le compare à d’autres plans, on se rend vite compte des similitudes ; alors que le Burkina n’est pas le Niger, le Tchad. Il faudrait que l’on détermine clairement ce que l’on veut pour le Burkina dans les 10, 20 prochaines années et faire des déclinaisons pour chaque cinq ans. Il nous faut une vision « longtermiste » à laquelle, le politique va s’accrocher et non le contraire !
Le Burkina Faso n’a pas besoin de mille solutions pour son développement qui se résume à offrir à manger aux populations, les éduquer, les soigner ! Mais tout ceci serait vain s’il n’y pas une certaine unité, une certaine cohésion entre les Burkinabè. Une seule main ne ramasse pas la farine, dit-on. Lorsqu’on regarde le Burkina Faso d’aujourd’hui, on a l’impression qu’il y a plus de tensions, de divisions que de vision commune !
S : Sur le plan de la gouvernance financière, quelles leçons les pays africains doivent-ils tirer de la crise du coronavirus?
S. J. T: En matière de gouvernance financière, il faut une gestion proactive. Lorsque la pandémie a éclaté, beaucoup de pays se sont retrouvés en manque de moyens financiers pour répondre à la crise. C’est la preuve que nous n’avons pas une gestion proactive des ressources publiques. Pourtant, un Etat doit avoir toujours des marges d’endettement, de lever des fonds. Le Burkina est à ce niveau mieux loti, son niveau d’endettement tournant autour de 43-45%, pour une limite de 70%.
Nous devrions comprendre que la gouvernance financière, c’est aussi de l’investissement à faire pour les générations futures. La structure actuelle de nos dépenses publiques fait plus de place à la consommation qu’à l’investissement. Aucun Etat ne peut se développer sur cette base ! Tout le monde veut des salaires, des compensations assez élevés, mais dans le long terme, que laisserons-nous comme Etat à nos enfants ? L’objectif n’est pas de tirer tout le monde vers le bas mais plutôt d’avoir une stratégie réfléchie permettant d’injecter un peu plus de ressources financières dans les investissements.
S : Le Burkina Faso est dans une année électorale, dans un contexte de double crise sécuritaire et sanitaire. Quel commentaire faites-vous de la situation de votre pays ?
S.J.T: Il faut d’abord reconnaître ce qui est fait de positif avant de mettre en exergue ce qui peut être amélioré. On constate déjà que, de 1960 à nos jours, notre pays a beaucoup progressé. Le régime de croissance y est appréciable, le taux de pauvreté baisse d’année en année. Au niveau de Ouagadougou et des régions, beaucoup de choses ont été faites et qui sont la résultante de plusieurs politiques. Malheureusement, depuis quelques années, la question sécuritaire nous pose problème. Nous n’avons pas une totale maîtrise des parties Nord et Est de notre territoire. Ce qui devrait être une préoccupation plus que nationale car l’intégrité territoriale est inhérente à l’ADN même du pays. Cette situation sécuritaire n’a pas facilité beaucoup de choses. Mais qu’est-ce qu’on fait pour s’en sortir et éviter d’y retomber dans le futur ?
Les forces de défense et de sécurité -que je félicite par ailleurs- et l’Etat font ce qu’ils peuvent. J’ai également une pensée pour nos compatriotes, les déplacés internes. A côté de l’action militaire, au niveau social, l’élite doit jouer sa partition. Aucun citoyen ne doit accepter qu’une fraction du territoire soit sous contrôle de groupes étrangers! Il faut absolument le retour de l’Etat régalien ! Nous devrions comprendre qu’il y a des compatriotes qui sont réellement en difficulté! Quand on est à Ouagadougou, on ne perçoit pas toute la souffrance des populations de ces zones difficiles. La solidarité manque beaucoup.
Pendant la pandémie de la COVID-19, il y a eu des initiatives de solidarité ; cette chaîne devrait s’étendre aux compatriotes déplacés internes qui souffrent énormément. La situation de mon pays me fait très mal au cœur ! Nous devrions savoir qu’en réalité, le pays est en guerre ! Par conséquent, chacun de nous devrait être un soutien pour l’Etat et non un élément perturbateur. On peut avoir des revendications sociales, des droits, mais tout cela n’est possible que quand il y a la sécurité.
Le civisme qui est très important pour tout pays, fait également défaut! On assiste à une sorte de laisser-aller, l’autorité de l’Etat est mise à mal. Lorsque l’Etat décide de quelque chose, il faut que cela s’applique, pourvu que sa politique soit légitime et légale. L’absence des jeunes sur la scène politique et décisionnelle malgré la jeunesse de la population constitue enfin une question centrale que l’on devrait courageusement poser sur la table. Depuis la révolution, ce sont les mêmes acteurs politiques qui sont là. Il faudrait préparer les jeunes à la gestion du pays pour éviter une rupture brutale. Je suis pour un rajeunissement générationnel progressif dans la cohésion, « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » !
S : En 2017, lors de votre prise de fonction comme représentant-résident du FMI au Togo, les relations entre ce pays et les bailleurs de fonds étaient tendues. Trois ans après, elles sont revenues au beau fixe. Comment avez-vous su gagner la confiance de Lomé ?
S.J.T: Lorsque nous commencions notre mission en 2017, nos relations n’étaient vraiment pas tendues ; seulement, il y avait certaines négociations pour la reprise du programme FMI qui trainaient. Auparavant, le Togo avait eu un problème avec cette institution pour l’annulation de sa dette que nous appelons initiative PPTE (ndlr : Pays pauvres très endettés). Sur ce point, le FMI avait interagi avec le Togo avec succès. Mais par la suite, on a eu des soucis au niveau de la comptabilisation de la dette publique ; et cela a pris du temps. En rappel, à la sortie de la crise politique togolaise, le pays avait un besoin criant d’infrastructures, de repositionnement.
Face à cela, les autorités ont eu recours à l’endettement intérieur privé à des taux exorbitants qui, souvent, étaient des montages financiers qui n’apparaissaient pas dans les comptes publics. Ce qui a permis de remettre l’infrastructure en l’état, mais avec l’effet secondaire du surendettement. Le gouvernement togolais s’est rendu compte que le quart des recettes servait à payer les services de la dette. Au vu de cette situation, le Togo a approché le FMI pour voir comment mettre en place un programme d’assainissement budgétaire.
Pour y parvenir, il fallait cerner tous les périmètres du problème. Mais comme toutes les dettes n’étaient pas déclarées ou étaient des montages financiers, les négociations ont pris du temps pour amener les Togolais à mieux appréhender la situation. Voilà ce qui constituait le contexte des négociations. A la question de comment nous avons su surmonter tout cela, il n’y a eu pas de bâton magique ! Il fallait montrer la réalité du problème et être un peu pédagogique !
S : Vous a-t-il fallu puiser dans la négociation et la diplomatie pour faire accepter des réformes ?
S.J.T: Il y a eu beaucoup de diplomatie, de discussions, d’échanges certes, mais il fallait simplement se mettre au service du pays. Ce que notre équipe a eu à faire était de montrer, d’une manière pédagogique, les vrais enjeux, les besoins réels pour remettre l’économie togolaise sur un chantier du développement. Car avec les problèmes de l’époque, l’économie n’était pas sur un chantier de stabilité macroéconomique. Avec une dette galopante, des déficits très exorbitants, des coûts du service de la dette très élevés, tout cela obère les dépenses publiques des secteurs sociaux.
L’objectif était de mettre toutes ces difficultés en exergue pour les autorités togolaises qui avaient déjà compris le problème, puisque ce sont elles qui ont sollicité le FMI. Il fallait trouver le juste milieu, savoir quelle pilule amère avaler sans tuer la croissance, la poule aux œufs d’or ! Il y a eu certes, de la diplomatie mais beaucoup plus de pédagogie !
S : Quel regard portez-vous sur les progrès accomplis par Lomé ? Et quelle est désormais la priorité du Fonds dans ce pays ?
S.J.T: Le Togo a beaucoup progressé. Lorsque nous commencions le programme, nous avions trois axes d’intervention à savoir l’assainissement budgétaire, du service financier et les réformes des finances publiques. Au niveau budgétaire, au début du programme, la dette togolaise était à environ 81% du PIB contre une norme UEMOA de 70%. En moins de deux ans et demi, – le programme finissait en mai 2020- le Togo est entré sous la barre des 70%. Et cela au prix d’un ajustement budgétaire assez fort ! C’était notre premier succès ! La seconde réussite qui est demi teintée porte sur l’assainissement du secteur bancaire.
Nous sommes arrivés à remettre deux banques publiques, qui avaient des difficultés, sur un chantier de privatisation, pas au sens négatif du terme mais pour amener des acteurs stratégiques pour remettre sur pied ces banques afin de protéger l’épargne des déposants. Le processus n’est pas achevé mais bien enclenché.
En même temps, nous sommes parvenus à protéger les dépenses sociales, en exigeant que les prévisions budgétaires pour les secteurs sociaux s’exécutent ! Cela est également une réussite ! Au niveau des réformes des finances publiques, nous avons amené le Togo à un début de budget-programme. Nous avons trouvé de nouvelles niches de recettes ; en matière de rationalisation des dépenses, nous avons fait la chasse aux dépenses inutiles. Il y a eu aussi un bond au niveau des indicateurs Doing Business. Il y a eu certes, beaucoup de succès mais les réussites ne viennent pas sans insuffisances.
Lorsqu’on fait par exemple, un assainissement budgétaire, la croissance en pâtit. Le régime de croissance du Togo a donc baissé, passant de 5,5% en moyenne à entre 3% et 4%. Mais cela s’explique aussi par la crise sociopolitique de 2017-2018 qui a plombé la croissance et engendré l’arrêt des investissements. Au vu du niveau élevé de la dette, nous avons demandé au Togo d’émettre un bon pour payer tous ces petits porteurs de dettes et d’arrêter l’infrastructure qui avait atteint un niveau hors normes UEMOA. Il est vrai que l’arrêt de l’investissement correspond à l’arrêt d’un stimulant de croissance mais nous avons privilégié la qualité des investissements.
Et cela a permis de ramener les finances publiques à un niveau acceptable et d’attirer les investisseurs privés. Pour ce qui des priorités de notre institution, nous n’en avons pas car, en réalité, nous nous arrimons aux priorités de l’Etat togolais. Le Togo a un Plan national de développement 2018-2021 et l’objectif est de faire du pays, un hub logistique et un hub financier de la région UEMOA. Les autorités togolaises ont prévu d’investir environ 6 500 milliards FCFA pour remettre leur économie à flot.
Les deux tiers doivent aller dans le secteur privé à travers trois axes : l’axe logistique et financier, l’axe industriel où elles veulent investir dans l’industrie légère comme le textile, l’agrobusiness et enfin, le socle social et la gouvernance étrangère. La première pierre que nous avons posée est d’amener le Togo à une stabilité macroéconomique et financière. Et aujourd’hui, le Togo peut aller sur les marchés financiers internationaux, il a déjà eu de l’argent à ce niveau. Le Togo peut se présenter comme un havre de paix pour les investissements. Le programme s’est arrêté mais à l’avenir, nous comptons enclencher un nouveau programme. Nous espérons voir le Togo poursuivre sur la voie de la stabilité macroéconomique.
Interview réalisée par
Mahamadi SEBOGO
Windmad76@gmail.com