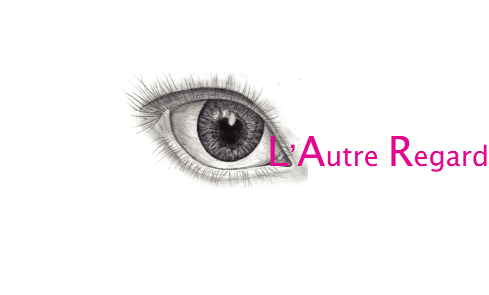Le 5 juillet 2019, le Burkina Faso a renforcé sa notoriété auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). En effet, c’est ce jour-là que le pays des Hommes intègres a inscrit les sites de métallurgie ancienne de réduction du fer de Tiwêga, Yamané, Kindibo, Békuy et de Douroula sur la liste du patrimoine mondial. Ce sacre vient porter à trois, les sites burkinabè gravés sur cette précieuse liste universelle. Les deux premiers étant les ruines de Loropéni inscrites en 2009 et le complexe W-Arly-Pendjari admis en 2017. Il y a lieu de féliciter, à juste titre, les autorités nationales qui ont travaillé à l’aboutissement de ce projet honorable pour la culture burkinabè. Cependant, comme l’a reconnu le directeur des sites classés patrimoine, Léonce Ki, l’inscription est la plus petite des étapes, sinon la plus insignifiante. Le plus difficile est de bien conserver ces «trésors» pour les léguer, intacts, aux générations futures. Il y a donc lieu de mettre en place un système efficace de surveillance, de gestion et d’entretien qui puisse les préserver et leur donner une plus-value. Heureusement que les acteurs du domaine l’ont vite compris et ont déjà mis en place des comités locaux de gestion des nouveaux sites inscrits. Et pour la constitution de ces comités, ils ont vu juste en choisissant des personnes qui côtoient quotidiennement les biens en question, tels les préfets et les maires. Le souhait est que cette même diligence se fasse sentir dans la valorisation des précédents sites, notamment les ruines de Loropéni. Qu’à cela ne tienne, les Burkinabè peuvent continuer à rêver grand, car selon certaines sources, le pays ne compte pas s’arrêter en si bon chemin en matière d’inscription de biens dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour ce faire, une longue liste est en attente d’éventuelle validation dans les années et décennies à venir. Il s’agit notamment de la cour royale de Tiébélé, des gravures rupestres de Markoye, Pobé-Mengao, Bobo-Dioulasso, Sindou et Gaoua, la biosphère de Bala et les nécropoles de Bourzanga. A tout point de vue, l’élan amorcé par la culture burkinabè est encourageant et plein d’espoir. S’il est maintenu ainsi, les activités touristiques feront un bond notable les prochaines années. Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Pour y arriver, d’énormes sacrifices restent à consentir. Il faut commencer par allouer un budget plus conséquent au département de la Culture, des Arts et du Tourisme, car la volonté et les idées seules ne suffisent pas pour maintenir cette montée en puissance. Il le faut surtout pour permettre aux chercheurs de continuer à découvrir et aux agents du secteur de travailler dans de meilleures conditions. Dans les normes, le département de la Culture devrait figurer parmi les ministères régaliens d’un pays comme le Burkina Faso dont les ressources naturelles sont très limitées. Cela permettra de développer une industrie culturelle digne de ce nom et de mettre en valeur les sites touristiques qui, bien exploités, sont d’importantes sources de devises. En outre, les évènements culturels qui ont fait la renommée du Burkina dans le concert des nations, tels que la Semaine nationale de la culture (SNC), le Festival panafricain du cinéma et de l’audiovisuel de Ouagadougou (FESPACO)… connaîtront une certaine aisance dans leur organisation.
Honoré KIRAKOYA