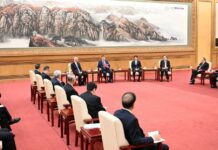De plus en plus, des femmes s’investissent dans la production du coton, un secteur fortement dominé par les hommes. C’est le cas de celles de Kari, Dankari et Bombi dans la province du Tuy (Houndé), région du Guiriko (ex-Hauts-Bassins). Evoluant jadis dans des Groupements de production de coton (GPC) masculins, elles se sont autonomisées en 2024-2025 en créant leur propre groupement, le GPC Dombeni-Séni. Pour la plupart des veuves, ses membres démontrent, de par leur engagement et leur détermination, qu’elles comptent dans la production du coton.
Mercredi 9 juillet 2025. Il est 9 heures à Kari, village de la commune de Houndé, province du Tuy, dans la région du Guiriko (ex-Hauts-Bassins). Malgré la pluie matinale, le ciel est toujours menaçant. Sous une fine pluie, Haketa Coulibaly assiste ses deux enfants, à l’aide des bœufs de trait, dans le sarclage des deux hectares et demi de coton au stade de plantule. « Avec les pluies ces deux jours, nous nous attelons à mettre à l’abri des eaux de ruissèlement l’engrais NPK que nous avons appliqué hier sur la superficie », explique la productrice. Dame Coulibaly a hérité de la production du coton de son défunt mari. La quarantaine remplie, elle poursuit la culture de l’or blanc avec ses enfants depuis six ans. « La production du coton a beaucoup de contraintes pour une femme, surtout pour le traitement », fait-elle savoir.
A Bombi, un autre village rattaché à la commune de Houndé, ce sont deux coépouses, Sahou Anadoun et Hazi Loupoué, qui se distinguent dans la production du coton. A les écouter, le coton est leur principale source de revenus depuis le décès de leur mari. Au titre de la campagne 2024-2025, ces deux veuves ont réussi la prouesse d’un chargement direct de 10 tonnes de coton sur les 12 hectares qu’elles ont emblavés. Elles viennent à peine (ndlr, il y a une semaine) de rentrer en possession de la paie de leur dur labeur. Et c’est sourire aux lèvres qu’elles s’engagent à rééditer cet exploit, voire faire plus. « Après avoir fait face aux dépenses de la famille, nous comptons acheter d’autres bœufs de trait pour suppléer les quatre, qui ont pris de l’âge, que nous avons actuellement. Ensuite, nous allons acquérir un tricycle pour faciliter le transport des récoltes. Et le reste, nous allons l’investir pour la production de cette année », détaille l’ainée des coépouses, Sahou Anadoun.
Le GPC pour s’autonomiser

Lamoussa Nikièma, elle, a la chance d’avoir son mari à ses côtés. Mais, elle s’est lancée dans la production de coton depuis quatre ans, même si elle avoue que son statut de femme lui rend la tâche pénible. « L’argent que je gagne, j’aide mon mari dans la scolarité des enfants et pour mes propres dépenses », soutient-elle. A l’image de Haketa Coulibaly, des deux coépouses de Bombi et de Lamoussa Nikièma, elles sont nombreuses ces femmes dans les villages de Kari, de Dankari et de Bombi à s’approprier la production du coton depuis des années, dans un secteur fortement dominé par les hommes. « La culture du coton est considérée comme un métier d’hommes, mais nous avons décidé de nous y investir malgré notre statut de femme », martèle Haketa Coulibaly avec fierté. « C’est certes difficile, mais nous nous sommes lancées dans ce métier sans peur ni crainte », insiste Hazi Loupoué.
Jadis, dans des Groupements de production de coton (GPC) des hommes, ces dames qui révolutionnent la culture de l’or blanc dans la région cotonnière de Houndé, ont décidé de voler de leurs propres ailes en créant en 2024 leur propre groupement. Dénommé GCP Domdéni-Séni, ce groupement, au départ, comptait 35 femmes, à majorité veuves. Pour leur première campagne « en solo », ces 35 amazones ont emblavé 65 hectares, avec à la clé, 71 tonnes de coton graine. Dirigé par Haketa Coulibaly, le GPC Dombéni-Séni, compte aujourd’hui 58 femmes. Elles prévoient un rendement d’au moins 100 tonnes pour la campagne 2025-2026 en cours. « Nous étions toutes dans des GPC des hommes, mais notre position de femmes nous brimait. Lorsque les intrants de la SOFITEX (ndlr : Société burkinabè des fibres textiles) arrivaient, ils ne nous donnaient pas la totalité de nos besoins. A la pesée aussi, nous n’avions aucune idée du poids exact de nos productions ainsi que nos gains exacts vu que ce sont eux qui étaient au-devant de la structure », soutient la présidente Coulibaly pour justifier la création du GPC Dombéni-Séni.
Le directeur de la région cotonnière de Houndé, Sié Serges Dah, confirme ces difficultés que les productrices de sa région rencontraient lorsqu’elles étaient sous le joug des GPC masculins. « Elles ont vécu des situations difficiles. Elles rencontraient des difficultés au niveau de la gestion des intrants parce que beaucoup d’entre elles ne recevaient pas les

intrants. Ce sont les hommes qui passaient les commandes. Ils agrandissaient d’abord leur champ avant de songer aux femmes. Ce qui ne permettait pas à ces femmes d’atteindre leurs objectifs de campagne », laisse entendre M. Dah. Nombreuses d’entre elles, comme Lamoussa Nikièma, étaient permanemment dans les impayés en raison de cette « injustice » des hommes. « C’était vraiment pénible pour nous en tant que femmes dans ces conditions de faire des gains dans le coton. Moi particulièrement, j’étais dans des impayés à la fin de chaque campagne cotonnière. Je n’arrivais pas à rembourser le crédit de la SOFITEX. N’eût été notre autonomisation avec le groupement Dombéni-Séni, j’allais abandonner le coton », témoigne avec amertume la productrice Nikièma.
Le sourire aux lèvres
C’est après une analyse de la situation que le directeur de la région cotonnière de Houndé et ses collaborateurs ont convaincu ces productrices à prendre leur autonomie afin d’être dans de bonnes conditions de productions. Sié Serge Dah ne regrette pas la mise en place de ce groupement féminin. Au contraire, il se dit émerveillé par leur engagement et leur détermination à s’investir dans la production de l’or blanc. « Je suis très impressionné par l’engagement de ces femmes et leur rendement au sortir de leur première campagne de production. C’est pourquoi mes agents et moi ne cessions de les accompagner. Les Agents techniques de coton spécialisé (ATCS) sont chaque fois à leurs côtés pour enseigner les techniques culturales », foi de M. Dah. Autonomes désormais, ce sont elles-mêmes, aux dires de l’ATCS de Kari, Beyé Nébié, qui pèsent leur coton pour la commercialisation. « Tout est transparent et clair, que ce soit pour les intrants ou pour l’argent du coton. Lorsqu’elles

finissent la pesée, elles viennent enregistrer leurs différents poids, et ensemble on calcule le net à payer, et les bénéfices. Tout le processus, de la distribution des intrants à la commercialisation, se passe avec elles dans la transparence totale », confie M. Nébié. L’ATCS dit être fier de travailler avec ces femmes qui sont réceptives et engagées dans leur activité. « Elles suivent les conseils sur les techniques culturales à la lettre », confie l’ATCS Nébié.
Désormais, ces productrices qui forcent l’admiration dans un secteur qui requiert de l’énergie et du courage, entrent en possession de tous leurs intrants agricoles et de la totalité de leur paie après la commercialisation de leur coton graine. Lamoussa Nikièma se dit ainsi dans de meilleures conditions pour produire. « C’est la deuxième campagne que nous produisons sous la coupe du GPC Dombéni-Séni et nous avons eu nos intrants demandés dans leur intégralité tout comme la paie sans aucun manquant pour la campagne 2024-2025. Cette année encore, les intrants nous ont été servis comme il se doit », dit-elle toute contente d’emblaver deux hectares pour la campagne 2025-2026. Et la physionomie de son champ de coton, au stade de début de floraison à la date du 9 juillet 2025, lui donne de l’espoir.
Le salut dans le coton
Devenues cheffes de famille depuis la disparition de leur conjoint, Hazi Loupoué et Sahou Anadoun trouvent leur salut dans l’or blanc. « Nous arrivons à faire face aux charges de la famille, à la scolarité des enfants ainsi que leur santé grâce au coton, depuis le rappel à Dieu de notre mari. Nous nous sommes procurées une motocyclette. Seulement nous n’avons pas pu encore construire », indique Hazi Lopoué.
Joséphine Lamoussa Bahaha assure les frais de formation en couture de ses deux filles avec les bénéfices du coton. Et à l’issue de la campagne en cours, elle envisage de leur trouver le matériel pour leur permettre de s’installer à leur propre compte. De petites productrices pour la plupart, les membres du GPC Dombéni-Séni, expriment le besoin de

bœufs de trait et une main-d’œuvre pour les assister dans le traitement de leurs cotonniers. Des doléances que la Nationale des fibres textiles entend étudier. « Nous allons examiner les différentes préoccupations qu’elles ont soulevées et voir ce que nous pouvons faire pour les accompagner. Déjà, cette année nous leur avons donné gracieusement les semences. Nous allons aussi voir dans quelles mesures les accompagner avec des prêts. Les hommes ont des tracteurs, pourquoi pas les femmes aussi ? Ce ne sont pas des choses impossibles. C’est réalisable si on se donne les moyens », indique le directeur de la région cotonnière de Houndé.
Dans les perspectives, le directeur de production cotonnière dans la zone SOFITEX, Adama Traoré, laisse entendre que le GPC Dombéni-Séni qui regroupe des femmes de trois villages (Kari, Bombi et Dankari) va être scindé pour fixer chaque groupe de femmes dans son village. « Notre perspective est de les stabiliser en créant des groupements au sein de chaque village. Cela permettra une adhésion plus massive des femmes, car lorsqu’elles sont dans leurs villages, c’est plus facile pour elles de se réunir parce qu’il n’est pas évident de quitter Dankari ou Bombi pour venir assister aux rencontres à Kari », dit Adama Traoré.
Kamélé FAYAMA
Produire les céréales à côté du coton
De petites productrices dans leur majorité, les femmes du GPC Dombéni-Séni n’arrivent pas à emblaver au moins trois hectares de coton requis pour bénéficier des intrants céréaliers. Et c’est l’une des préoccupations soulevées par la présidente du GPC, Haketa Coulibaly. Dame Coulibaly souhaite que les décideurs de la SOFITEX les soutiennent avec les intrants afin qu’elles puissent produire, à côté du coton, les céréales pour se nourrir. « On nous donne les intrants pour produire le coton sans ceux des céréales. Finalement, ce que nous gagnons dans le coton, on le met dans les céréales pour se retrouver en fin de compte sans rien. Si on pouvait nous aider avec les intrants pour nous permettre de produire aussi le maïs, on pouvait faire autre chose avec nos gains du coton », lance dame Coulibaly. Une doléance entendue par le directeur de production dans la zone SOFITEX, Adama Traoré, qui promet de faire une exception afin de leur permettre d’avoir les intrants pour les céréales. « Nous allons alléger les conditions d’octroi des intrants céréaliers pour elles. Seulement, nous craignons qu’elles ne prennent trop d’intrants pour ne pas être à mesure de payer. Néanmoins, nous allons étudier la faisabilité et leur donner ce qui est nécessaire pour produire les céréales », foi du directeur de production de coton à la SOFITEX.
K.F