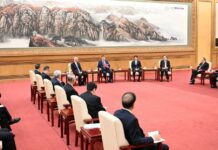Au Burkina Faso, les femmes façonnent les richesses agricoles du pays. De Zorgho à Bobo-Dioulasso, en passant par Ouagadougou, elles transforment, créent et innovent. Dans leurs mains, le karité devient du beurre précieux, le néré se mue en soumbala parfumé, les céréales se transforment en farines nutritives, les tubercules en snacks croustillants, les fruits en nectars savoureux. Animées par une ambition commune, ces entrepreneures veulent désormais faire rayonner le label « Made in Burkina » bien au-delà des marchés de quartier.
Ouagadougou, quartier Tampouy. Il est 10h, ce lundi 24 novembre 2025. Devant sa modeste cuisine, Félicité Kiema épluche des bananes plantains. Avec son assistante, elle s’active à les frire. Coiffées de charlottes blanches et les mains gantées, les deux dames respectent scrupuleusement les règles d’hygiène alimentaire. Penchées, l’une découpe des lamelles de plantain tandis que l’autre surveille, sur le foyer à gaz, l’huile chauffant doucement où dorent déjà, lentement, de nombreux morceaux.
A « Felik Food’s», c’est le début d’une longue journée de production de snacks croustillants. Tout commence au marché, avec l’achat de la matière première. « Pour les chips salées, la transformation se fait immédiatement pour garder le croquant et la saveur originelle du fruit. Pour les sucrées, nous laissons la banane plantain mûrir », confie Mme Kiema. Sous ses yeux, donc, les lamelles de plantain se transforment en pépites dorées.

Une fois sorties du feu, elles reposent quelques minutes, refroidies par l’air ambiant avant d’être ensachées. Outre les chips de plantain salées simples, épicées ou sucrées et à l’ail, selon la promotrice, « Felik Food’s » propose aussi des chips de patate douce, de pomme de terre et des cocos grillés. Malgré une production encore artisanale, Félicité Kiéma fabrique des croustilles en quantité, vendues à partir de 500 F CFA. Si son activité a débuté modestement, elle fait aujourd’hui vivre sa famille et rémunère deux employées.
De la survie à l’agro-business
A quelques kilomètres de là, au quartier Rayongo, Rebecca Toé a aussi choisi l’agroalimentaire pour échapper à la pauvreté. Il y a dix ans, le décès de son époux aurait pu la briser. Au lieu de cela, elle a transformé son petit étal de bouillie et de galette de rue en une véritable manufacture sous hangar. Surnommée « Maman Rebecca », sous ses doigts, le maïs est transformé en brisure, couscous ou farine, le petit mil et sorgho sont mués en farines et granulés ; le riz est décliné en couscous ; le soja est transformé en farine, en huile ou en brochettes et le fonio est précuit.
Sa spécialité est de sublimer l’igname et le niébé en couscous et spaghettis. « Ce sont nos produits phares. Nos aliments sont très nutritifs et rapides à préparer. Le consommateur gagne du temps tout en mangeant sainement », explique cette quinquagénaire dont les prix varient de 250 à 25 000 F CFA pour les gros volumes. Grâce à cette activité, elle a assuré la scolarité de ses enfants, transformant son deuil en moteur de développement.
Tout comme Félicité et Rebecca, elles sont nombreuses, les femmes qui ont décidé de miser sur la transformation des ressources agricoles locales.

Si la production agricole est dominée par les hommes, ce sont les femmes qui créent de la richesse dans le secteur, selon le Pr Salimata Traoré, enseignante-chercheuse à l’université Thomas-Sankara et experte en économie agricole. Ollo Arnaud Kam, directeur général de la promotion de l’économie rurale, confirme cette tendance. « Les femmes représentent environ 70 % des acteurs dans la transformation des produits agropastoraux », affirme-t-il. Sur un total de 215 entreprises enregistrées auprès de la Fédération nationale des industries de l’agro-alimentaire et de la transformation du Burkina (FIAB), 140 sont dirigées par des femmes, soit un taux de 65,11%.
Elles sont celles qui empêchent la matière première agricole de quitter le sol burkinabè sans avoir créé, au passage, de l’emploi et de la richesse. A Bonheur-ville, Alphonsine Saba illustre parfaitement cette dynamique. A la tête de « La Meunière du Faso », elle a décidé d’apporter une plus-value à l’arachide, une activité devenue sa principale source de revenus.
Samedi 6 décembre 2026, dans son entreprise, l’organisation est méthodique. Pendant que certaines employées s’attèlent à la vaisselle et au nettoyage des lieux, d’autres procèdent au dépelliculage manuel des arachides torréfiées, sur une table en bois. La patronne fait savoir que les graines ainsi débarrassées des pellicules seront vannées, triées, puis broyées en pâte avant le conditionnement. En plus de la pâte, elle transforme cette culture de rente en beurre, huile, tourteaux et arachides enrobées salées, sucrées, à l’ail ou épicées.
« Mon arachide, il n’y a pas son deux ! », lance-t-elle, avec une fierté contagieuse. Chez dame Saba, la qualité est une exigence non négociable. « La pâte, c’est zéro point noir », insiste-t-elle. Elle dit combattre l’aflatoxine par une sélection rigoureuse des graines. Avec quatre employées permanentes, elle distribue ses produits dans les alimentations de la capitale, proposant des pots allant jusqu’à 36 000 F CFA pour les clients.
« Du 100 % local… »

A Bobo-Dioulasso, la capitale économique, Fatoumata Konaté, nutritionniste de formation, a aussi bâti sa réputation sur une gamme de produits finis dérivés de l’arachide (huile, poudre et pâte) auxquels elle a adjoint la poudre de kongo et la farine de pois de terre. Sa structure, « KF Industries et Services », ne se contente pas de l’arachide. En mai dernier, elle a lancé « Bara », une farine enrichie composite faite à base de maïs, soja, arachide, pain de singe contre la malnutrition infantile dès 6 mois.
« C’est du 100 % local, mais c’est très nutritif », ajoute la nutritionniste. Offrant 422 kilocalories par 100 grammes, poursuit Mme Konaté, elle surpasse les normes de l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (390-400 kcal). Riche en protéines, glucides, lipides et micronutriments, sa formulation répond précisément aux besoins nutritionnels des nourrissons. Selon elle, c’est une réponse aux produits de complément importés, souvent inaccessibles ou inadaptés.
Des orfèvres de l’agroalimentaire, les Burkinabè domptent toutes les spéculations : elles concassent, malaxent, extraient et précuisent. Grâce à leur génie, les céréales, les oléagineux et les légumes perdent leur rusticité pour devenir des produits finis, prêts à conquérir les marchés. Marie Madeleine Pouya s’érige en gardienne du goût local et parie sur l’agroalimentaire « Made in Burkina ». Elle a décidé de s’attaquer au défi du
« bien manger » urbain avec son entreprise « Faso Kom Sayan », basée à Saba. Depuis son
exploitation située dans le village de Komkaga, elle gère un réseau de 20 hectares de cultures maraîchères dont l’amarante, tomates, oignons, épinards, asperges…

La prouesse de Mme Pouya ? Les sauces « M’zindo ». Grâce à une technologie de déshydratation et de pré-cuisson solaire, elle propose des kits de sauces prêtes en 15 minutes, 100 % naturelles. Du kit individuel à 750 F CFA au grand sac familial à 22 500 F CFA, elle libère les femmes de la corvée de cuisine tout en garantissant une alimentation sans produits chimiques. « L’approche est centrée sur le bien-être des femmes et la santé publique », précise la spécialiste genre. En libérant du temps de travail pour les femmes, cela contribue à leur épanouissement, à la résilience familiale, à la santé et à l’autonomie alimentaire du pays, foi de Mme Pouya. La start-up emploie plus de 100 femmes dont une cinquantaine de déplacées internes.
A Ziniaré, c’est le piment qui fait la loi sous l’égide de Marion Seynou, incarnant à merveille la philosophie du champ à l’assiette. Sur sa ferme d’un hectare, la promotrice de Zinyiri SARL cultive diverses variétés de piments locaux et importés, qu’elle transforme sur place. En mêlant savamment les arômes, elle crée « Yamchi », une purée de piment frais 100 % burkinabè.
Pour Marion Seynou, ce projet dépasse la simple activité économique. Elle ne se voit pas seulement comme une fabricante de sauce piquante, son ambition est de fédérer les producteurs locaux, structurer la filière et offrir un débouché durable à des centaines de petits exploitants. Une démarche qui valorise le savoir-faire local tout en créant une chaîne de valeur pérenne pour les producteurs de piment.
Créer de la richesse et renforcer la résilience
La transformation des denrées agricoles locales n’est plus une simple activité de subsistance pour la gent féminine. Elle est désormais un puissant catalyseur pour l’autonomisation économique des jeunes filles et des femmes.
Zalissa Ouédraogo, ingénieure en industrie agroalimentaire, a lancé « MariaTrans » en

2019, alors qu’elle était encore étudiante et cherchait à joindre les deux bouts. Aujourd’hui, son unité à Bobo-Dioulasso traite l’hibiscus, la mangue, l’ananas, la papaye, le gingembre et la goyave pour en faire des granulés, des nectars et des confitures. Elle produit 600 bouteilles de nectar par jour. D’étudiante « précaire », elle est passée au statut de cheffe d’entreprise générant un chiffre d’affaires à six chiffres.
Même succès pour Samira Zongo et sa marque « SAVIZ », Santé Vitale par les Zingibéracées. Cette ingénieure agronome a misé sur le curcuma et le gingembre, des rhizomes aux vertus thérapeutiques et culinaires méconnues. Avec un chiffre d’affaires annuel minimum de 3 millions F CFA, elle prouve que les épices locales sont un marché d’avenir.
La transformation est aussi une aventure humaine. A Zorgho, la coopérative Wend-Ndila, dirigée par Odette Kaboré, regroupe cinquante artisanes. Mardi 2 décembre 2025, sous des charlottes blanches et des blouses protectrices, une douzaine de femmes s’activent avec une minutie artisanale. Dans ce laboratoire de la résilience, le couscous de maïs est granulé au tamis de bois puis conditionné selon les normes sanitaires. Elles se sont donné pour mission d’anoblir les richesses agricoles de la région de Oubri et du Burkina Faso.
Ici, les céréales deviennent aussi des bouillies enrichies, tandis que l’hibiscus, le tamarin, la mangue, le citron, la poudre de toédo et la liane sont métamorphosés en nectars précieux. Le beurre de karité, le soumbala et savons liquides complètent cet éventail de produits locaux. Pour la présidente, cette alchimie est avant tout un moteur économique.
« Transformer, c’est créer de la richesse », martèle-t-elle. En deux décennies, la structure est devenue un pilier social, soutenant veuves et personnes déplacées tout en servant d’incubateur pour la jeunesse.
A Bobo-Dioulasso, la société coopérative « Sara » dont Djemila Touré est membre, valorise exclusivement le manioc, 100 % burkinabè, cultivé sans engrais chimiques sur les terres fertiles de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Pama-Sô ou Bama. L’atelier des femmes de Bindougousso se distingue par la pureté de ses produits que sont le placali, le gari, le tapioca et l’attiéké. Des produits qui s’arrachent comme de petits pains… « Nous n’arrivons même pas à satisfaire la demande », s’exclame Djemila. Le clou du projet ? Une collaboration avec la recherche scientifique pour produire une farine de manioc panifiable, capable de remplacer le blé importé dans les boulangeries.
« La transformation constitue un levier majeur de création de richesses et d’inclusion sociale », affirme M. Kam, directeur général de la promotion de l’économie rurale. En valorisant les récoltes, ce secteur sécurise les revenus des producteurs, réduit les pertes

post-récolte et renforce la résilience économique rurale face aux chocs. Il génère des emplois durables tout en garantissant la souveraineté alimentaire nationale.
Le Pr Salimata Traoré, enseignante-chercheure à l’université Thomas-Sankara, partage cette vision. Pour elle, la transformation agroalimentaire constitue un puissant instrument d’autonomisation féminine. En diversifiant leurs sources de revenus, les femmes augmentent leur pouvoir d’achat et contribue à la vie du ménage. Au-delà des bénéfices financiers, l’enjeu est également sanitaire. La transformation permet une disponibilité alimentaire annuelle, favorisant la diversification nutritionnelle. « Le secteur de la transformation est un levier très stratégique de développement social et économique, de sécurité alimentaire, aussi et surtout d’autonomisation des femmes au Burkina Faso », insiste le Pr Traoré.
Les défis du 100% burkinabè
Si le tableau semble idyllique, la réalité du terrain est jalonnée d’obstacles. L’insuffisance
financements, les équipements artisanaux, le manque et la cherté des emballages, les coûts énergétiques élevés ou encore les exigences rigoureuses de certification… pèsent lourdement sur la compétitivité. Selon ces entrepreneures, ces freins logistiques et normatifs grèvent considérablement leurs coûts de production.
Agathe Yerbanga, à la tête de « Magnificat Gourmet », est la première au Burkina à avoir fait certifier son yaourt. Mais ce gage de qualité a un prix.
« La certification n’est pas obligatoire, la concurrence est donc rude, parce que certifier un produit engendre des frais importants. Ceux qui ne certifient pas vendent moins cher, menaçant notre rentabilité », déplore-t-elle. Pour elle, comme pour Zalissa Ouédraogo, la labellisation est un « fardeau financier » que les Petites et moyennes entreprises (PME) portent souvent seules.

Le manque de contenants est un autre cri du cœur. Au Burkina, aucune verrerie ne produit de flacons. Résultat : les entrepreneures doivent importer. Ce qui alourdit considérablement le coût de revient.
De son côté, Marie Madeleine Pouya préfère transformer ces obstacles en défis, tout en restant lucide sur la réalité du secteur : « Ce sont des défis communs à toutes les transformatrices. Ces charges grèvent les couts de production, alourdissent nos coûts de revient. Si nous ne parvenons pas à lever ces barrières, nous ne ferons que subir la loi du marché. »
Face à ce cri du cœur des actrices de terrain, l’experte en économie, la Pr Salimata Traoré, plaide pour un allégement des coûts. Selon elle, bien que l’agroalimentaire burkinabè ait un « bel avenir », sa survie dépend d’une baisse drastique des frais de production. Seule la réalisation d’économies d’échelle permettra aux produits locaux de rivaliser avec les importations, laisse entendre l’économiste. Pour les entrepreneures, le salut passera par un soutien étatique fort, notamment dans l’accès aux emballages de qualité et la réduction des frais de certification.
Face à ces doléances, l’Etat burkinabè tente de réagir. Ollo Arnaud Kam indique que plusieurs leviers sont activés, notamment à travers le fonds Dumukafa et divers programmes, pour financer et équiper les coopératives de femmes. Dans le cadre de l’« Offensive agro-pastorale », les autorités ont suspendu temporairement les exportations pour sécuriser les stocks nationaux.
Parallèlement, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) renforce son dispositif de collecte (achats groupés) pour approvisionner directement les unités locales. Enfin, le ministère promeut l’agriculture contractuelle, créant un lien direct et sécurisé entre producteurs et transformateurs. « Ces mécanismes visent à garantir la souveraineté alimentaire tout en optimisant les revenus des femmes, pivots de cette chaîne de valeur », déclare M. Kam.
Conquérir le Burkina et le monde
Pour donc concurrencer les produits importés, les entrepreneures agroalimentaires doivent s’aligner sur les exigences de qualité (packaging, étiquetage, certification…) tout en tendant vers un prix abordable pour le consommateur local. Déterminées à s’imposer, elles multiplient les stratégies pour accroître leur visibilité. Entre foires commerciales et journées promotionnelles, elles investissent massivement le terrain, mais aussi l’espace numérique.
C’est le cas de Félicité Kiema qui, depuis sa cuisine transformée en atelier de production, a fait des réseaux sociaux son principal canal de commercialisation. A l’approche des fêtes de fin d’année, période propice aux réceptions et aux retrouvailles familiales, l’entrepreneure redouble d’ingéniosité pour promouvoir ses chips artisanales. En ligne, elle multiplie les publications, invitant les internautes à sublimer leurs tables avec ses « amuse-bouche haut de gamme », avec des visuels soignés, mettant en scène des chips dorées et croustillantes.
Si son ambition ultime reste la création d’une unité industrielle de production de snacks, Mme Kiema concentre pour l’instant ses efforts sur un objectif plus immédiat. Elle veut intégrer les réseaux de distribution nationaux. A l’image de nombreuses transformatrices, elle rêve de voir ses produits trôner dans les rayons des boutiques de quartier comme des grandes surfaces, aux côtés des marques importées.

Cette aspiration se heurte toutefois à de nombreuses difficultés. Venue approvisionner une supérette du quartier Karpala à Ouagadougou, en thé fait à base de kinkéliba, moringa, baobab, arthémesia, djeka, verveine, vétiver, petit cola, citronnelle, feuilles de séné, gingembre, etc., Ramata Sawadogo dresse un constat amer. Selon elle, la collaboration avec la grande distribution relève davantage d’un parcours de combattant que d’un partenariat équitable.
« Les produits locaux sont peu valorisés. Dès qu’on dit que c’est local, il y a une barrière », déplore-t-elle, dénonçant des conditions contraignantes, notamment le dépôt-vente. Mme Sawadogo explique qu’elle doit déposer son stock sans paiement immédiat, surveiller elle-même son rayon, remplacer les produits abîmés, et attendre parfois deux ou trois mois pour être payée, même après avoir fourni de nouveaux lots. « Je doute que les produits importés subissent le même traitement », s’indigne-t-elle.
Depuis Bobo-Dioulasso, FK Industries et Services tente pourtant de relever ce défi. Sa pâte et son huile d’arachide gagnent progressivement les marchés et les points de vente de plusieurs villes, tandis que la farine infantile « Bara » s’impose dans certaines pharmacies. Pour sa promotrice, Fatoumata Konaté, le véritable enjeu reste un changement de mentalités en faveur des produits locaux, souvent plus adaptés et plus riches sur le plan nutritionnel.
Ambitieuse, Marie Madeleine Pouya veut faire de la sauce « N’Zindo » « un plat populaire », consommé dans les écoles, universités, hôpitaux et camps d’immersion patriotique. « Ce que nous voulons vraiment, c’est conquérir tout le Burkina Faso, dans ses coins et recoins, pour que N’Zindo soit utilisé dans toutes les familles et tous les ménages », affirme-t-elle, avec détermination.
A terme, elle vise le marché de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), après avoir déjà introduit ses produits au Sénégal, au Canada et aux Etats-Unis.
Optimiste et résolument tournée vers l’avenir, Marion Seynou, promotrice de la purée de piment frais « Yamchi », nourrit aussi de grandes ambitions.
A l’horizon de cinq à dix ans, elle entend positionner les produits agroalimentaires « Made in Burkina » sur les étals internationaux, notamment en France, aux Etats-Unis et en Chine. D’ici trois ans, un seuil décisif de production devra être atteint afin de démontrer que les produits burkinabè peuvent rivaliser, tant par la qualité que par la présentation, avec les standards mondiaux de la grande distribution.
Djakaridia SIRIBIE
dsiribie15@gmail.com