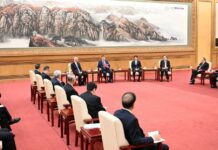HEMA Kala Brigitte, Attachée de recherche à l’Institut des Sciences des Sociétés/ Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (INSS/CNRST), Ouagadougou/Burkina Faso
Résumé
Ce document de vulgarisation est tiré de l’article scientifique « Pratiques agricoles des migrants burkinabè en Côte d’Ivoire et investissements socio-économiques liés à la culture du cacao », Publié dans Tropicultura, Volume 36 (2018), Numéro 2, 299-313 URL : https://popups.uliege.be/2295-8010/index.php?id=836. DOI: 10.25518/2295-8010.836
Ce document présente les activités agricoles des émigrés Burkinabè en Côte d’Ivoire et leurs investissements socio-économiques réalisés au Burkina Faso. Il vise à susciter des autorités publiques un regard particulier sur cette communauté qui est la plus importante diaspora du Burkina dont la contribution parait énorme aussi bien pour le pays de départ que pour le pays d’accueil au moment où l’Etat est en phase de se doter de dispositions légales pour encadrer le phénomène migratoire.
- Introduction
La population burkinabè est reconnue pour son ardeur dans le travail, et cela depuis la période coloniale. Ce critère a prévalu à sa sollicitation pendant cette période à travers des conventions de migration signées avec différents pays (Côte d’Ivoire en 1960, Gabon en 1973 et Mali en 1969) entre l’Etat de la Haute Volta et les pays de la sous-région (OIM, 2016). Ces facteurs historiques ont fortement contribué aux mouvements de la population burkinabè vers l’extérieur. A l’interne, les déplacements de populations s’inscrivent dans une politique d’occupation du territoire suscitée par les conditions climatiques favorables à la production agricole dans certaines parties du pays par rapport à d’autres.
De nos jours les motifs de déplacements des populations sont la quête d’emploi, la recherche de meilleures conditions de vie et de travail, l’ambition de faire fortune. Pour l’année 2024, l’OIM dénombrait 739 800 personnes en situation de migration de main d’œuvre pour le Burkina Faso. Les plus importantes communautés des émigrés burkinabè après la Côte d’Ivoire, résident au Ghana et au Mali. Dans les deux premiers pays, elles sont concentrées dans les activités agricoles. Une migration de main d’œuvre que l’OIM[1] définit comme le mouvement de personnes d’un pays d’origine à un autre pays dans le but d’y obtenir un emploi.
Cet article se focalise sur les émigrés burkinabè en Côte d’Ivoire pour comprendre leurs pratiques agricoles ainsi que les logiques d’investissements dans la région du Yaadga (Nord) et de Nando (Centre-ouest) au Burkina Faso.
Echec des initiatives et dispositions d’encadrement des migrants et développement des réseaux d’insertion des migrants
L’histoire du Burkina Faso est marquée de part sa constitution par de grands mouvements de ses populations depuis le Xème siècle qui se sont réunis sur cette terre autrefois la Haute-Volta pour devenir le Burkina Faso en 1984 (Dabiré, 2009). Pendant la période coloniale, ces populations ont servi de mains d’œuvre dans des travaux de chemin de fer, de constructions maritimes, agricoles, suscitant au niveau de l’Etat des prises d’orientations visant à organiser ces sorties de compatriotes du territoire. Toutefois, ces tentatives d’encadrement du phénomène n’ont pas abouti. Les migrants eux-mêmes ont développé des initiatives pour s’organiser et faciliter leur insertion.
L’adoption de la politique nationale de population en 1991 puis révisée en 2000 constitue un cadre de gestion de l’évolution de la population dans son ensemble. Cependant, il ressort de cette politique de la population que sa forte croissance, sa mobilité associées au manque de moyens adéquats pour un suivi permanent rendent difficiles l’encadrement de sa dynamique (PNP, 2000). Le Burkina compte un nombre important de sa population résidant dans les pays voisins. On dénombre sa plus importante diaspora en Côte d’Ivoire.
Ces dernières années, des tentatives, d’actions gouvernementales à l’endroit de Burkinabé vivant à l’extérieur ont abouti à la validation en juillet 2025 d’une stratégie nationale de la migration de main-d’œuvre (SNMMO) 2025-2029 assorti d’un Plan d’actions opérationnel (PAO).
- Méthodologie
Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un programme pluridisciplinaire (PreSeD/CI) de recherche dont l’objectif est de développer des connaissances sur les conséquences des crises politico-militaires des années 2000 en Côte d’Ivoire sur les dynamiques des paysages naturels et la disponibilité des terres pour l’agriculture de subsistance. Une méthodologie mixte (quantitative et qualitative) a été adoptée ciblant les émigrés exploitant des plantations cacaoyères de retour temporaire au Burkina et en Côte d’Ivoire. Les enquêtes se sont déroulées au Burkina Faso (régions du Yaadga et de Nando) et en Côte d’Ivoire (centre-ouest) dans la sous-préfecture de Dania. Au Burkina, les enquêtes ont mobilisé 120 émigrés œuvrant dans la production cacaoyère tandis qu’en Côte d’Ivoire une quinzaine d’entretiens avec les ménages burkinabè exploitant des plantations de cacao ont été réalisés.
Source : Hema et al.(2018)
Source : Gautier et al. (2019) https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2019-v63-n179-180-cgq06583/1084232ar/
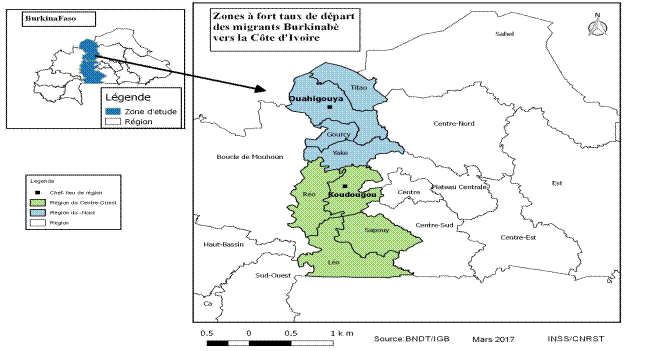
- Résultats
Les migrants burkinabè en Côte d’Ivoire, une main d’œuvre à vocation agricole
D’une manière générale, la question de l’immigration représente un enjeu économique majeur pour les pays concernés mais au premier plan pour le pays d’accueil des migrants. Pour la Côte d’Ivoire, on retient que l’immigration a un impact économique positif, sur la population et semble ne pas entraîner d’effets négatifs pour la population autochtone sur le plan de l’emploi (OCDE/OIT,2018).
D’après les sources historiques, le développement du secteur agricole ivoirien après les indépendances attire une main d’œuvre considérable dans les zones rurales. Face à cette réalité se dessinait un défi démographique avec une répartition illégale de la population ivoirienne (Bekoin 2015). La Côte d’Ivoire offrait à ces migrants des conditions propices à leur savoir-faire. Une vocation qualifiée de naturelle pour la plupart de ces émigrés qui pratiquaient prioritairement les activités agricoles dans des zones de départ. Toutefois au fil des ans, ces pratiques ont contribué à exercer une pression sur l’espace agricole qui a parfois suscité des conflits fonciers. Une très forte concentration des migrants burkinabè est répertoriée dans la région du Haut Sassandra. De cette communauté plus de 80% s’adonnent à la culture de cacao. Ils mènent ainsi leur activité sur une superficie moyenne de 4,47 hectares. Leur motif d’émigrer en Côte d’Ivoire se résume à leur ambition de faire fortune, le manque d’emploi, et la pauvreté des sols pour leur activité agricole. Des entretiens, il ressort ceci « L’avantage d’aller là-bas (Côte d’Ivoire) c’est pour travailler dans les champs de café et de cacao. Ce sont des cultures de rentes et nos terres du Burkina nous servent pour les cultures vivrières, un producteur de café et cacao disposant 20ha, rencontré à Ouahigouya.
Les mécanismes d’accès des Burkinabè à la terre
Les démarches entreprises pour avoir accès au capital foncier diffèrent d’un exploitant à un autre. Les mécanismes ont été primordialement traditionnels, relevant des autorités coutumières et des propriétaires terriens ivoiriens. Le tableau 1 présente quelques statistiques relatant les modes d’accès à une exploitation sur une population de 120 exploitants. Les enquêtes menées dans le Haut Sassandra donnent quelques chiffres que nous résumons dans le tableau 1.
Tableau n°1: Modes d’accès aux exploitations agricoles par les migrants burkinabés
| Modes | Exploitants burkinabè |
| Par achat | 66% |
| Par location | 16% |
| Travail partagé | 14% |
| Autres modes d’accès | 4% |
Source : données d’enquêtes dans le Haut Sassandra
La location est un mécanisme saisonnier dont les terres en location sont vouées à la production vivrière. Ce sont les bas-fonds qui sont objet de location. Le mode d’exploitation par le travail partagé est utilisé par les migrants qui ne disposent pas suffisamment des ressources financières pour s’acquérir ou louer leurs propres exploitations. Ils optent pour ce mécanisme qui consiste dans un engagement ou arrangement généralement verbal, convenu avec un propriétaire terrien dans lequel le migrant burkinabè met en valeur l’espace mis à sa disposition en plantant les cacaoyers. Les dispositions de l’arrangement prévoient que la superficie une fois valorisée soit équitablement répartie entre le propriétaire et le ou les migrants exploitants.
Une autre stratégie exploitée par les migrants burkinabè pour disposer d’exploitations agricoles pour la production cacaoyère est d’exploiter les réseaux communautaires parfois bien restructurés pour leur insertion en Côte d’Ivoire. Un exploitant agricole expliquait que les démarches par les réseaux communautaires consistaient pour le nouveau venu dans la localité ou depuis le Burkina à adhérer une association de ressortissants burkinabè, à approcher le responsable de l’association communément appelé « Moog-Naaba ». Celui-ci entretient généralement de très bonne relation avec la communauté hôte pour faciliter les démarches d’accès à la ressource terre pour les activités agricoles. Ce processus peut aussi être engagé par le candidat à la migration depuis le pays d’origine. Ce qui est qualifié de réseaux réducteurs de coûts de la migration.
Dans le Haut Sassandra, plus de 30% des exploitants burkinabè occupent des superficies entre deux et quatre hectares, et 29% occupent des plantations de plus de six (06) hectares.
Logiques d’investissement des migrants burkinabè de Côte d’Ivoire au Burkina
Les migrants burkinabè d’une manière générale gardent le contact avec leurs proches restés au pays. Ils entretiennent cette relation à travers les échanges en natures et en numéraires. D’une manière générale, les soutiens des migrants à leur proche du pays de départs sont liés à l’altruisme du migrant, à des décisions familiales et même stratégiques.
Chez ces migrants burkinabè de Côte d’Ivoire, les transferts financiers vers leurs proches sont motivés par les soutiens ponctuels tels que les évènements heureux (naissances, mariages) ou malheureux (décès, catastrophes), les aides annuelles (fêtes ou cérémonies coutumières, rentrée scolaire), les aides mensuelles telles que subvenir aux besoins de parents âgés, etc. Ces échanges renforcent le pacte social et consolide la solidarité dans les familles de ces migrants. La production cacaoyère constitue une importante source de revenus pour les pays d’accueil et d’origine. Les émigrés burkinabè qui mènent ces activités dans le Haut Sassandra produisent par an en moyenne 1,9 tonnes et perçoivent en moyenne par production plus 1,6 millions par an.
Ces émigrés burkinabè planteurs de cacao investissent prioritairement dans l’immobilier qu’ils mettent en location dans la perspective d’un retour définitif. Certains développent des activités commerciales. Ces choix peuvent s’expliquer par l’analphabétisme ou de niveau d’instruction primaire, leur méconnaissance des opportunités d’investissement dans d’autres secteurs que l’immobilier.
- Conclusion
On retiendra que la population burkinabè pratique une migration de main d’œuvre depuis la période coloniale favorisée par les conventions signées avec d’autres pays dont les difficultés ont eu raison de leur non-poursuite. Ce qui a suscité chez les migrants une organisation en réseau facilitant leur insertion et le maintien de liens avec la mère patrie. Les migrés burkinabè contribuent au développement socioéconomique du pays à travers leurs apports en nature dont les vivres, les transferts de fonds pour soutenir leurs proches et investir dans leur pays d’origine. Malgré les difficultés autrefois rencontrées dans les tentatives d’encadrement de ce phénomène par des dispositions légales, la volonté réitérée de l’Etat burkinabè de mieux structurer et tirer davantage s’est matérialisée par l’adoption de politique telle que la Stratégie nationale de migration de main d’œuvre. Elle nécessite cependant une connaissance de l’organisation des compatriotes à l’étranger dont la forte cohorte réside en terre ivoirienne.
- Références bibliographiques
Bekoin T. R.(2015) La migration des Burkinabè en Côte d’Ivoire et la question foncière :Origine et enjeu d’un conflit de survie (1920-2002).Revue BAOBAB, 2ème semestre 229-246
Dabire B., Kone H. & Lougue S., 2009, RGPH analyse des résultats définitifs thème 8: migrations, Ouagadougou INSD, 150p
Dabire B. H. (2016) Migration au Burkina Faso. Profil migratoire 2016. OIM , Genève, 97p.
Koukougnon, W. G., Loba, A. D. F. V. & Guédé, C. M. (2019). Méthodologie pour la cartographie de la couverture en équipement de service d’eau potable dans l’espace rural : le cas du Haut-Sassandra (centre-ouest, Côte d’Ivoire). Cahiers de géographie du Québec, 63(179-180), 201–212. https://doi.org/10.7202/1084232ar
OIM Migration de la main d’œuvre. Division de la migration de main-d’œuvre et de la migration assistée. Sur https://publications.iom.int/system/files/pdf/labour_migration_infosheet_fr.pdf
OCDE/OIT (2018), Comment les immigrés contribuent à l’économie de la Côte d’Ivoire, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264293304-fr
- Zongo (2003) La diaspora burkinabè en Côte d’Ivoire. Trajectoire historique, recomposition des dynamiques migratoires et rapport avec le pays d’origine. Politique africaine n° 90 – juin 2003, 113-126
[1] https://publications.iom.int/system/files/pdf/labour_migration_infosheet_fr.pdf